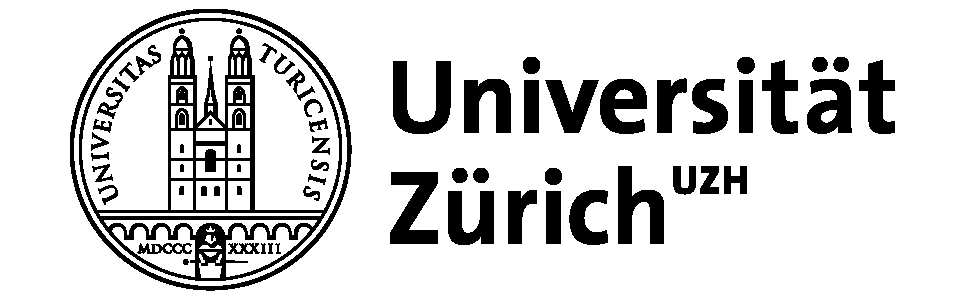Quand le « moi » et l’ « autre » se confondent : altération de l’altérité dans les échanges épistolaires de Theodore Dreiser au moment de la publication de Sister Carrie
Élise Cantiran
CNRS (ITEM) / Université Eötvös-Loránd Budapest / Bourse savoir CRSH
Abstract: This article aims to explore how Dreiser’s letters reveal the dynamics of identity and power in his professional relationships. The analysis shows how the concept of identity and self tends to blur, with Dreiser navigating between the expression of an « I », often powerless, and a more secure « we ». By examining the use of personal and collective pronouns, the study highlights the complex interplay between individual and group identities, illustrating the nuanced power dynamics and strategic adaptations within the literary community during the Nineteenth Century.
c
Keywords: Naturalismes transatlantiques; Correspondance; Identité collective; ethos; altérité
1 Introduction
Le mouvement littéraire du naturalisme, né en France, prend une dimension internationale avec l’émergence de la mondialisation au XIXe siècle. Yves Chevrel (1982) note que ce courant a traversé les frontières lors d’une deuxième vague en Europe et d’une troisième en Amérique du Nord. Aux États-Unis, le naturalisme répond à un besoin de documenter les nouveaux contextes sociaux urbains et innovations industrielles. Des ouvrages comme The Beginnings of Naturalism in American Fiction (Åhnebrink 1950) incluent des auteurs comme Hamlin Garland, Stephen Crane, Theodore Dreiser et Frank Norris. Salvan (1943) analyse les traits saillants soulignés par la critique contemporaine : « Dès 1888, des revues signalent la présence de ce naturalisme. Elles en attribuent l’origine à des influences européennes. Les traits principaux de ce mouvement sont : l’objectivité, la franchise, l’absence apparente de préjugés, la conscience de la qualité conventionnelle de la morale. Une philosophie déterministe ou fataliste est à la base de l’œuvre des naturalistes » (Salvan 1943 : 153). Le chercheur évoque l’exportation d’un modèle européen, tandis que de nombreuses autres études remettent en cause cette relation d’influence au profit d’un transfert culturel.[1] En ce qui concerne la notion de réseau naturaliste étatsunien, il n’en est que peu question, même si les membres de ce réseau se connaissent, et entretiennent à minima des relations professionnelles. Dans l’ensemble, leurs situations rappellent celle de Zola vingt ans plus tôt, lorsqu’il cherchait à attirer l’attention sur sa fiction. Un des enjeux majeurs pour eux est la publication et, en conséquence, les bonnes relations avec des intermédiaires. Les chercheurs s’accordent à dire que le naturalisme étatsunien a atteint son apogée avec les romans de Theodore Dreiser, dont Sister Carrie (1900) est une œuvre emblématique. Bien que l’auteur étatsunien ait affirmé ne pas avoir lu Zola avant de composer ce texte, l’intrigue se distingue par ses descriptions des milieux urbains de Chicago et New York, rappelant certains tomes des Rougon-Macquart comme L’Assommoir, Au Bonheur des Dames ou Nana. Carrie bénéficie d’une ascension sociale à la façon de Nana ou Octave tandis que son amant Hurstwood tombe dans la déchéance, tel Coupeau. Dans les années 1920, Dreiser se rapproche des idéaux socialistes et communistes, cherchant à améliorer les conditions de vie en Amérique du Nord et à décrire les vérités cachées de l’existence.
Dans ce contexte de quête d’engagement politique et de justice sociale, les lettres de Dreiser et de ses contemporains revêtent une importance particulière. Outre leurs œuvres fictionnelles, les documents épistolaires offrent un éclairage précieux sur le naturalisme aux États-Unis, en dévoilant à la fois le métadiscours entourant les romans et l’autoreprésentation des écrivains, qu’ils soient isolés ou intégrés dans des réseaux littéraires et intellectuels. Ainsi, cet article propose d’explorer les liens entre ethos et épistolaire. Notons que la correspondance des naturalistes français a été l’objet de nombreuses études, parmi lesquelles nous pouvons mentionner celles de Pagès (1999), Humphries (2004) ou Jovicic (2000). Les études sur la correspondance des écrivains naturalistes, notamment Zola, Goncourt ou Maupassant, révèlent une altération de l’autre à travers l’écriture épistolaire. La lettre, en tant qu’acte de communication différée, impose une autoreprésentation qui varie en fonction du destinataire, qu’il s’agisse d’un interlocuteur intime, professionnel ou d’un membre du réseau littéraire naturaliste (Lacroix 1984, Jovicic 2000). Ces échanges mettent en lumière des stratégies d’adaptation du „moi“ qui évoluent selon la cible, modulant ainsi l’image de soi présentée dans le texte. En réseau, ces écrivains ajustent leur discours en fonction des attentes ou statuts de leurs correspondants (Grassi 1998, Chartier 1991). Les lettres deviennent alors un espace d’interaction, où la socialité et la relation sont plus importantes que l’individu lui-même (Maingueneau 2004). Enfin, l’étude de la correspondance permet aussi de comprendre comment les écrivains modulent leur identité en fonction de leur parcours personnel, entre besoin de reconnaissance et affirmation de leur statut littéraire. Le colloque récent « Naturalismes en réseaux »[2] a permis d’identifier une véritable identité de réseau dans le cénacle naturaliste français, ainsi qu’une altération du moi dans une expression collective.
En effet, les enjeux de l’épistolarité viennent d’une notion venue de l’ancienne rhétorique, la notion « d’ethos » (ἦθος). Ce concept a été développé dans la Rhétorique d’Aristote, où il est présenté, au même titre que le pathos et le logos, comme une des clés du discours efficace ; l’ethos, selon Aristote, est une image de soi que produit l’orateur pour persuader son auditoire de sa probité et son honnêteté. C’est la raison pour laquelle une partie conséquente des études épistolaires s’intéressent à une relation duelle : notons par exemple le travail de Calas (2013) concernant la relation de Madame de Sévigné et Madame de Grignan notamment à travers les épidictiques.
La correspondance de Dreiser avec d’autres auteurs et acteurs du monde de l’édition montre une communication complexe impliquant non seulement un dialogue duel mais aussi des références à des connaissances communes. L’usage des pronoms „nous“ et „vous“ révèle une construction d’identité collective, et les lettres contribuent à former un groupe décrivant la réalité étatsunienne avec précision tout en se démarquant des autres cultures.
Cet article a ainsi pour but d’identifier chez Dreiser les marques qui conduiraient à l’hypothèse d’une identité de réseau se développant aussi aux États-Unis, sous l’impulsion initiale du naturalisme, dont les racines s’inscrivent profondément dans le monde moderne.
Ainsi, nous analyserons la correspondance de Dreiser pour comprendre comment il exprime une identité collective, dans la démarche de s’interroger sur une potentielle fragmentation du moi, concordant avec la révolution industrielle[3]. Nous commencerons par présenter le corpus de ses lettres publiées, puis nous examinerons comment l’identité personnelle se transforme en réseau social, créant des rapports de force ou de confiance par l’inclusion ou l’exclusion des destinataires.
2 Présentation du corpus
Le corpus des lettres de Dreiser est particulièrement riche. Édité en trois volumes, il existe encore des archives inédites dans plusieurs bibliothèques de Philadelphie. Pour notre analyse, nous nous concentrerons sur les lettres échangées avec les éditeurs et autres acteurs du monde du journalisme, publiées entre 1897 et 1908. Cette période inclut la publication de Sister Carrie et éclaire les conflits et défis identitaires perceptibles dans la correspondance de Dreiser.
En 1900, Dreiser obtient un contrat pour la publication de son premier roman et se réjouit publiquement de la nouvelle. Il communique avec ses contacts afin de diffuser sa bonne fortune. Cependant, au bout de seulement quelques semaines, Doubleday et Page demandent à être libérés de leurs engagements après des retours négatifs de certains rédacteurs. Il se fait conseiller par ses amis proches pour développer divers arguments, mettant notamment en avant le fait d’avoir déjà communiqué autour de ce roman dans tous ses cercles : revenir sur la publication le mettrait donc dans un grand embarras. Finalement, le volume est publié mais Doubleday et Page ne feront que très peu de publicité, et les ventes sont basses. Ce n’est qu’en 1907 qu’une agente réussira à promouvoir Sister Carrie et en fera un best-seller.
Ces lettres révèlent des échanges variés, parfois courtois, où la subjectivité joue un rôle crucial. Elles montrent aussi la dissolution de l’identité de la firme éditoriale dans un anonymat collectif, tandis que Dreiser réaffirme sa volonté individuelle, tout en faisant valoir ses divers soutiens.
3 Les dynamiques de l’identité et de l’affirmation dans l’usage de la première personne du singulier
Dans une correspondance, l’utilisation du pronom « I »[4] offre à l’épistolier l’opportunité d’affirmer son identité et sa volonté de manière directe. Pourtant, dans certaines interactions, cette utilisation se trouve souvent complexifiée par l’ajout de nombreux modalisateurs, créant ainsi une instabilité dans l’expression de soi. Dans sa lettre à Arthur Henry, son ami venu lui apporter son soutien dans une période de déception, Dreiser emploie le pronom de première personne en le modalisant de diverses nuances, illustrant la situation difficile et décevante. L’écrivain démontre une certaine assurance dans ses lettres à Page : « I would », « I should », « I may », « I believe » (Dreiser 1900a : 57-58, 1900b : 61), assurance mise à mal dans sa lettre à son ami Arthur Henry : « I shall », « I think », « I am inclined » (Dreiser 1900c : 51). Il reflète ainsi la déstabilisation de son éthos par le soudain revirement de situation. Cette utilisation fluctuante du « je » semble être influencée par les circonstances changeantes, révélant ainsi les tourments internes de l’épistolier face à une décision à prendre. Le « moi » paraît alors mis en doute, prêt à osciller sous l’effet des différentes possibilités envisagées, dans une tentative de faire valoir ses opinions tout en jonglant avec les subtilités du langage pour exprimer ses désirs. La lettre adressée à Page, l’éditeur avec lequel il est alors en conflit, présente une tonalité spécifique, marquée par des concessions initiales avant de revendiquer ses positions de manière plus catégorique. L’instabilité du pronom « I » dans les lettres de Dreiser exprime une tension constante entre l’affirmation de soi et la remise en question de sa place dans le monde littéraire. Chaque modalisation du « je » signale une hésitation face à une réalité changeante et des attentes sociales mouvantes. Cette oscillation, loin d’être anodine, témoigne d’un processus de déconstruction et reconstruction de soi, où l’épistolier réévalue continuellement son éthos en fonction des réponses de ses interlocuteurs.
Malgré une volonté de compromis, comme en attestent les phrases « I have given the situation very serious consideration » et « find that the question of release will not need an answer from me » (61), l’épistolier prépare progressivement son interlocuteur à une prise de position ferme. Par la suite, il flatte les qualités de romancier de Page en affirmant que « The letters expressing this warm approval have been, as you might well surmise, documents of value to me » (62), soulignant ainsi l’importance de son soutien. Cependant, Dreiser met en garde contre les conséquences d’un éventuel échec de la publication en déclarant que « I would be looked upon as an object of curious interest if the work now failed to appear » (62). Enfin, il exprime sa dépendance à l’égard du soutien collectif en soulignant que « I depend upon the judgment of the magazine editors, as regards my shorter contributions for a livelihood » (62). Ainsi, Dreiser met en évidence l’altération de sa propre altérité face à cette nouvelle décision, en utilisant une série de modalisateurs pour exprimer ses préoccupations tout en soulignant le rôle crucial de l’autre dans cette dynamique.
En revanche, les éditeurs, représentant une firme collective, utilisent rarement le pronom « I », préférant souvent un « we » exclusif pour représenter leur entreprise. Cette utilisation du pronom de première personne se trouve ainsi associée à des souvenirs collectifs ou à des garanties de relations pacifiques, comme en témoignent des expressions telles que « I told you that we… », ou « I am sorry to report to you, the more uncertain », ou encore « I think I told you that, personally, this kind of people did not interest me, and we find it hard… ». Ces références constantes au collectif renforcent souvent les conseils prodigués à l’auteur, comme en témoigne la déclaration selon laquelle « If you were to ask my advice » (62). Kerbrat-Orecchioni explique l’ambivalence de ce pronom « nous » dans le schéma énonciatif, précisant qu’il peut être inclusif, intégrant le destinataire dans le collectif, ou exclusif, lorsqu’il parle au nom d’un groupe dont le destinataire est exclu (Kerbrat-Orecchioni 2014 : 45-50). Le « nous exclusif » souligne ainsi la position collective de l’éditeur, contribuant probablement à la décision de publication de Dreiser.
En 1907, dans une lettre adressée à Flora Mai Holly, l’agente littéraire qui a grandement contribué à la promotion de Sister Carrie, Dreiser adopte un ton plus apaisé, utilisant le pronom « I » et des modalisateurs qui rappellent sa lettre à Arthur Henry. Contrairement à ses échanges avec Page, Dreiser emploie ici le pronom de la première personne en interaction avec le « you », affirmant par exemple que « I think I owe you a letter of acknowledgment » (Dreiser 1907a : 84), ou « I think you deserve all the good wishes which I can offer you ». L’absence de « nous inclusif » dans cette correspondance est notable, bien qu’il fasse son apparition dans une lettre adressée à Mencken, où Dreiser évoque « our mutual advantage » (Dreiser 1907b : 86).
L’utilisation du « nous » et du collectif en général représente souvent un argument de poids dans les négociations littéraires, tandis que le simple usage de la première personne se pare généralement de modalisateurs lorsque le soutien collectif fait défaut. À travers son recours au pronom « nous », Dreiser ne cherche pas seulement à se protéger, mais aussi à s’inscrire dans une identité collective qui le légitime en tant qu’auteur. Ce réseau littéraire, s’il est parfois implicite, joue un rôle fondamental dans sa quête de reconnaissance. En s’appuyant sur un « nous » collectif, Dreiser tente d’échapper à l’isolement que pourrait lui imposer un « je » solitaire et vulnérable. Cependant, cette intégration au réseau ne va pas sans heurts, comme en témoignent ses nombreux conflits épistolaires, notamment avec Page et Doubleday. Face à la fragmentation du moi induite par les nouvelles formes de communication dans le travail, l’épistolier s’efforce de maintenir une cohérence narrative de soi. Dreiser incarne ainsi une figure moderne, confrontée au brouillage des frontières entre sphères privées et publiques, où l’identité individuelle se redéfinit constamment dans le cadre de réseaux professionnels et sociaux. Ces dynamiques révèlent des enjeux de domination et de confiance, tout en soulignant les stratégies adaptatives de Dreiser. En analysant ces interactions spécifiques, nous sommes confrontés à une riche toile de relations humaines, marquées par des jeux de pouvoir, des négociations identitaires et des stratégies de persuasion.
4 Enjeux de pouvoir et identités de réseau
L’observation du petit groupe d’intellectuels dans lequel Dreiser évolue témoigne des dynamiques d’inclusion et d’exclusion qui animent les cercles et les réseaux sociaux. Cet environnement social complexe rappelle que nulle relation n’est exempte de conflit, comme en témoigne le « Manifeste des Cinq », symbole de l’exclusion d’une certaine faction d’écrivains par l’école naturaliste. Ces enjeux révèlent souvent une quête d’identité individuelle à travers une recherche de dissolution dans un ensemble plus vaste, mettant en lumière les subtilités des interactions humaines au sein de ce groupe.
Un examen attentif de la correspondance entre Dreiser et ses pairs offre un aperçu précieux de ces dynamiques relationnelles. Par exemple, la lettre de Page à Dreiser, en réponse à celle du 23 juillet, se distingue par l’emploi soudain du pronom de première personne, jusqu’alors totalement absent. La réaction de Dreiser semble avoir incité Page à se fondre dans un « nous » collectif, tout en prodiguant de nombreux conseils, cherchant ainsi à convaincre Dreiser par l’expérience. Notons notamment une proposition de conseils où la responsabilité est clairement portée par le « we » : « in giving this advice, and in asking you to release us, we are (we wish you to make sure) serving your best interests-both financial and literary » (Dreiser 1900b : 60). Cette lettre exige également une réponse définitive, forçant ainsi Dreiser à prendre position et à clarifier sa décision. Les modalisateurs abondent dans ce contexte, exprimant à la fois la fermeté des propos et la difficulté de l’échange.
En contraste, la correspondance de Dreiser avec Miss Holly présente une tonalité différente, où les modalisateurs comme « I think » prédominent, sans recours au « nous ». Cette approche plus nuancée souligne les variations subtiles dans le langage épistolaire de Dreiser en fonction de son interlocuteur et de la nature de la relation. Ces ajustements discursifs ne sont pas seulement le reflet d’une adaptation aux circonstances, mais révèlent également les enjeux de domination et de pouvoir qui structurent les relations au sein des cercles littéraires. L’usage du « nous », notamment par les éditeurs, constitue une tentative de légitimation de l’autorité collective et une manière de diluer la responsabilité individuelle, tout en maintenant une pression sur l’écrivain. Dreiser, bien conscient de ces jeux de pouvoir, emploie des stratégies similaires pour faire valoir son propre statut tout en ménageant ses relations.
Pour Dreiser, l’identité d’auteur ne se construit pas dans un isolement artistique, mais au contraire, à travers une série d’interactions dynamiques avec ses pairs, ses éditeurs et les critiques. Le choix de s’associer à un collectif ou de défendre une position individuelle reflète une constante oscillation entre autonomie et dépendance vis-à-vis de ces réseaux. En fin de compte, ces lettres montrent que l’identité d’un écrivain se forge dans un processus de négociation continue, où l’appartenance à un groupe littéraire peut autant être une source de soutien qu’un lieu de tension.
Les dynamiques de pouvoir, d’identité et d’altérité sont en constante évolution dans les lettres de Dreiser. À travers ses échanges avec divers acteurs du monde littéraire, l’écrivain étasunien révèle les subtilités de la communication épistolaire et les stratégies utilisées pour affirmer son identité et défendre ses intérêts. Cette dialectique entre l’individu et le collectif souligne un enjeu fondamental de l’époque : dans un monde littéraire en pleine mutation, Dreiser et ses contemporains doivent composer avec l’évolution rapide des réseaux amicaux, intellectuels et professionnels. À travers la correspondance, Dreiser semble à la fois se distancier et se fondre dans ce collectif, renforçant sa position d’auteur tout en intégrant les codes et les attentes du milieu éditorial. Ce processus reflète une quête constante d’équilibre entre la préservation de son éthos individuel et l’adaptation stratégique aux exigences d’un marché littéraire de plus en plus concurrentiel.
Il ressort de notre analyse que l’utilisation du pronom de la première personne, bien que souvent associée à une expression individuelle de soi, est souvent teintée de nuances et de subtilités. Lorsque Dreiser emploie le « je », c’est souvent pour exprimer ses pensées, ses doutes, voire sa vulnérabilité face aux situations auxquelles il est confronté. Cependant, cette expression individuelle est souvent contrebalancée par l’utilisation du « nous », du collectif, qui vient renforcer l’argumentation et la position de l’écrivain.
Cette dialectique entre l’individuel et le collectif révèle les enjeux de pouvoir et de communication qui sous-tendent les échanges épistolaires de l’époque. Dreiser évolue entre ces deux sphères, utilisant les modalisateurs et les stratégies de persuasion pour défendre ses idées et ses intérêts tout en préservant son image et sa réputation.
L’altération de l’altérité dans le collectif témoigne non seulement d’une volonté de protection et de dissimulation de la responsabilité individuelle, mais aussi d’une recherche de connexion et d’appartenance à un groupe plus vaste. Dreiser, tout en étant conscient des jeux de pouvoir et des conflits inhérents aux relations humaines, utilise des stratégies de recours au collectif pour s’armer.
Ainsi, l’étude de la correspondance de Theodore Dreiser nous offre un aperçu des intrications de l’identité individuelle et collective dans le contexte du monde littéraire du XIXe siècle, et se propose d’apporter une autre nuance à la modulation du rapport à l’autre. Ces échanges épistolaires nous invitent à réfléchir aux nuances de la communication humaine et à la façon dont elle façonne nos relations et nos interactions sociales.
Références bibliographiques
Åhnebrink, Lars (1950). The Beginnings of Naturalism in American Fictions: A Study of the Works of Hamlin Garland, Stephen Crane and Frank Norris with Special Reference to Some European Influences, 1891-1903. Uppsala, Almqvist and Wiksells.
Calas, Frédéric (2013). « Les mots pour se dire : étude de l’ethos discursif de Mme de Sévigné dans sa correspondance (année 1671) », in : Bombart, Mathilde (éd.), Connivences épistolaires. Autour de Mme de Sévigné (Lettres de l’année 1671). <https://facdeshumanites.univ-lyon3.fr/medias/fichier/communication-f-calas_1360338817913.pdf> [01.04.2025].
Chartier, Roger (1991). La Correspondance. Les Usages de la Lettre au XIXe Siècle. Paris, Fayard.
Chevrel, Yves (1982). Le Naturalisme, Étude d’un Mouvement Littéraire International. Paris, PUF.
Dreiser, Theodore (1959). Letters of Theodore Dreiser : a Selection. Édité avec Préface et Notes par Robert H. Elias. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 3 volumes.
Dreiser, Theodore (1900a). « Letter to Walter Hines Page, July 23, 1900 », in : Dreiser (1959 : 55-58).
Dreiser, Theodore (1900b). « Letter to Walter Hines Page, August 6, 1900 », in : Dreiser (1959 : 59-62).
Dreiser, Theodore (1900c). « Letter to Arthur Henry, July 23, 1900 », in : Dreiser (1959 : 50-54).
Dreiser, Theodore (1907a). « Letter to Flora Mai Holly, September 18, 1907 », in : Dreiser (1959 : 84-85).
Dreiser, Theodore (1907b). « Letter to H. L. Mencken, October 19, 1907 », in : Dreiser (1959 : 85-86).
Grassi, Marie-Claire (1998). Lire l’épistolaire. Paris, Armand Colin.
Jovicic, Jelena (2000). « Les Réseaux Épistolaires (1850-1900): Un Espace Virtuel », L’Esprit Créateur, 40 (4), 68-79.
Humphries, Jeanne (2004). Lettres de femmes à un homme de lettres : La construction du sujet épistolaire au féminin dans les lettres envoyées à Zola [doctoral thesis], Toronto, University of Toronto.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2014). L’Énonciation. De la Subjectivité dans le Langage. Paris, Armand Colin.
Lacroix, Jean (1984). « Correspondre au XIXe siècle : l’esprit de la lettre », in : La Correspondance (Édition, fonction, signification). Actes du Colloque franco-italien d’Aix-en-Provence, 5-6 oct. 1983, Université de Provence, Centre Aixois de Recherches Italiennes, 155-200.
Maingueneau, Dominique (2004). Le discours littéraire, paratopie et scène d’énonciation. Paris, Armand Colin.
Pagès, Alain (1999). « Le Discours de la Correspondance », Les Cahiers Naturalistes 73, 9-23.
Pizer, Donald & Earl Harbert (1982). Dictionary of Literary Biography. Volume 12: American Realists and Naturalists. Detroit, Gale.
Salvan, Albert J. (1943). Zola aux États-Unis. Vol. 8, Providence, Brown University Studies.
- Selon Pizer & Harbert (1982 : IX), le mouvement a un écho différent outre-Atlantique où ses limites sont plus historiques que littéraires : « La période approximative du mouvement américain connu sous le nom de réalisme et de naturalisme est placée classiquement entre la fin de la guerre de Sécession et le début de la Première Guerre mondiale ». ↵
- Colloque « Naturalismes en réseaux (Montpellier) » organisé par Marie-Astrid Charlier du 14 au 16 novembre 2023 à Université Paul-Valéry Montpellier 3, Site Saint-Charles, Auditorium. ↵
- Les innovations technologiques, telles que le télégraphe (1838) et le téléphone (1876), ont considérablement amélioré la vitesse et l’efficacité des communications. Le télégraphe, en particulier, a permis une transmission plus rapide des informations à travers de grandes distances, facilitant les échanges entre les auteurs, les éditeurs et les journalistes. Cette accélération des communications a permis une circulation plus rapide des manuscrits et une réponse plus rapide aux critiques et aux tendances littéraires émergentes. ↵
- Pour faciliter la lecture et respecter la version originale, nous inclurons les pronoms utilisés par Dreiser dans leur langue initiale. ↵