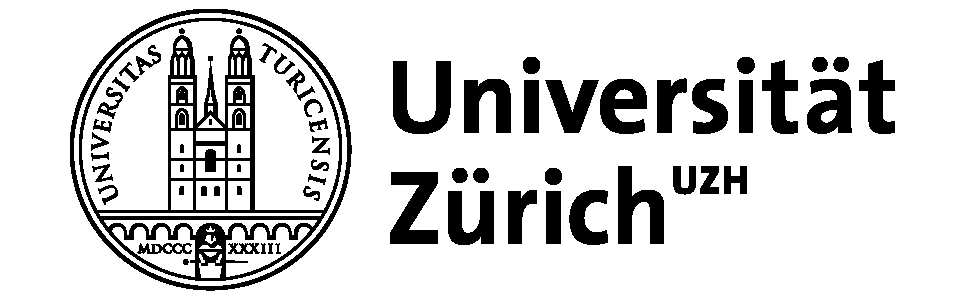Parler en réaction ou la constitution agonistique d’une identité linguistique : Lectures discursives et auto-ethnographiques
Adrien Mathy
Université de Liège
Abstract: This analysis is an exploratory work combining autoethnography and discourse analysis and focuses on our linguistic identity as it is built on three alterities. It is built on (1) the practice of a Belgian French that does not exist as such and is marked by linguistic insecurity; (2) Walloon-like practices themselves in tension and (3) a French-Dutch speaking linguistic conflict. From then on, it appears that this identity was built on three alterities which in turn define it: (1) otherness in relation to the well-spoken French language considered as a hegemon which dominates a necessarily marked peripheral speech; (2) otherness in relation to the Walloon language historically spoken in the territory and spoken by the ancestors; (3) otherness finally in relation to the Dutch language spoken by ‘the Other’, constructed and antagonized by and through politically situated narratives and counter-narratives. In the conclusion, we will consider how these identities in tension can be mobilized in an agentive way in order to produce rhetorical effects.
c
Keywords: gentivité rhétorique; francophone de Belgique; ethnographie linguistique
1 Introduction
Ce travail repose sur une hypothèse exploratoire : nous considérons que l’identité, ainsi que le substrat expérientiel de cette dernière, se manifestent discursivement et sont, en dernière analyse, discursivement constitués. Cette hypothèse repose sur un double postulat : premièrement, sans construction sociodiscursive l’expérience n’est constitutive de rien ; deuxièmement, la pratique de la langue impose à son locuteur une inscription dans un univers discursif, un imaginaire. Ainsi, il nous semble que notre identité linguistique s’est constituée spécifiquement au sein d’un champ agonistique qui antagonise une identité spécifique par rapport à des altérités. Ce champ est la construction sociodiscursive consubstantielle à notre expérience de locuteur. Par ailleurs, notre identité se constitue non seulement par rapport aux langues pratiquées, mais aussi par rapport à des langues qui ne sont pas parlées. Autrement dit, ce n’est pas tant la pratique linguistique que l’imaginaire linguistique qui est constitutif de notre identité – cet imaginaire étant une construction discursive explorable comme tel.
Aussi, nous souhaitons étudier en quoi telle identité linguistique est, en dernière analyse, une construction discursive – ce qui n’enlève rien à la prégnance expériencielle propre au vécu. Cette proposition de lecture n’a pas pour but d’aboutir à des généralisations ou de produire un cadre d’analyse de l’identité. Elle cherche simplement un retour théorisé d’une observation empirique qui s’inscrit dans une double perspective : discursive et auto-ethnographique. Dans un premier temps, nous envisagerons donc les modalités d’articulation entre auto-ethnographie et analyse du discours. Dans un second temps, nous étudierons la manière dont fonctionne discursivement cette identité, en envisageant le champ agonistique que nous évoquions. Enfin, nous conclurons en considérant les possibilités de mobilisation agentive de cette identité et de performation rhétorique conséquentes.
2 Entre (auto-)ethnographie et analyse du discours
Nous souhaitons envisager notre identité linguistique en considérant que notre terrain est le discours, d’une part, et, d’autre part, que notre expérience linguistique est structurée en amont par des discours. Il convient néanmoins d’envisager dans quelle mesure l’articulation de l’ethnographie et de l’analyse du discours est pertinente. L’approche dite auto-ethnographique repose sur un principe simple : prendre le chercheur comme objet d’étude. Se considérer soi-même comme objet – a fortiori si l’on se considère soi-même en tant que chercheur comme objet – suppose une démarche subjective et réflexive qui repose sur le récit de soi. Dans cette perspective, notre objectif est de développer une approche auto-ethnographique de notre identité de locuteur – qui, par ailleurs, percole avec notre identité de chercheur (cf. infra). De cette manière, nous cherchons à épaissir la description de l’identité linguistique dite du francophone de Belgique de sorte à l’appréhender dans sa granularité et à mettre au jour les tensions internes à cette identité – qui, in situ, présente toujours un écart riche par rapport aux constructions in abstracto produites par l’induction sociologique ou sociolinguistique qui hypostasie parfois des idéaux-types. En outre, il s’agirait par cette démarche de pointer la nécessité d’auto-ethnographie dans toute étude de l’identité linguistique qui, en miroir, renvoie le chercheur à sa propre identité linguistique.
Notons toutefois un décalage par rapport à la démarche originelle qui suppose de produire un récit de soi. Or, au lieu de produire un récit de soi, nous pouvons étudier l’ensemble de notre production discursive relative à notre identité linguistique – antérieure à tout souhait de l’étudier. Nous pouvons, en quelque sorte, étudier nos discours comme s’ils étaient des discours d’un autre – articulant ainsi auto-ethnographie et analyse du discours. Si cette dernière consiste à envisager des énoncés constitutifs de discours du point de vue des conditions de production desdits énoncés, afin de produire une lecture « non subjectiviste de la subjectivité » (Gillot 2013, par. 6), les manières d’appréhender et d’atteindre cet objectif épistémique sont variées. Il apparaît justement que l’analyse du discours a pris un tournant ethnolinguistique en envisageant les discours du point de vue des groupes qu’ils constituent, c’est-à-dire de « dégager un processus énonciatif qui d’un même mouvement organise les textes et l’espace social des hommes qui à divers niveaux vivent à travers eux » (Maingueneau 1992: 114). Envisager l’identité linguistique de façon discursive suppose cette approche ethnologique : l’identité linguistique implique un rapport spécifique à la communauté linguistique, qui est structurée par des pratiques discursives, au même titre que ladite communauté linguistique et que l’ensemble des discours qui sont aux fondations de cette identité et de cette communauté. Bref, l’identité linguistique traverse pleinement tant l’ordre social que l’ordre du discours. Dès lors, l’ethnologie et l’analyse du discours permettent, conjuguées, de rendre compte des discours en tant qu’ils constituent des pratiques sociales ; de la même manière que l’analyse du discours et la linguistique, conjuguées, permettent de rendre compte des discours en tant qu’ils sont matérialisés linguistiquement. Par conséquent, pour rendre compte des rapports entre nos discours et les pratiques et structures sociales dont il est question, nous devons explorer ethnologiquement lesdites pratiques en proposant une démarche d’observation qui est, précisément, la démarche auto-ethnographique que nous avons présentée.
Aussi, il nous semble qu’envisager le langage dans ce qu’il permet de construire les identités, dans une dimension expériencielle, permet de réconcilier la lecture subjectiviste et objectiviste a priori incompatible (cf. Auchlin 2016). Par ailleurs, il nous semble que le cas spécifique que nous voulons étudier à travers notre identité linguistique, à savoir l’identité linguistique du locuteur francophone de Belgique, appelle à un retour réflexif d’ordre auto-ethnographique : en effet, un regard sur les travaux linguistiques sur le sujet permet de mettre en lumière la motivation auto-ethnographique préscientifique des études sur l’identité. À partir d’un récit de soi, le scientifique problématise une question ou trouve une motivation intrinsèque à cette problématisation. En outre, dans certains cas, la frontière entre le discours scientifique et le récit personnel, ou entre le discours scientifique et le discours politique ou militant est poreuse – songeons aux travaux de Klinkenberg (cf. 2015) ou Francard (cf. 1998). En substance, il nous semble que par l’auto-ethnographie, il devient possible de rendre compte des « plis les plus singuliers de chaque individu » (Lahire 2019 : 11) de l’identité linguistique et, de fait, d’articuler réflexivité auto-ethnographique et appréhension de la nature située des savoirs produits sur l’identité linguistique – ces savoirs pouvant être axiologiquement marqués. Ce constat sur la motivation expérientielle des travaux scientifiques sur l’identité linguistique nous a amené à relire, de façon rétrospective, certains de nos propres travaux : en interrogeant les motivations préscientifiques ou extrascientifiques d’une étude antérieure, portant sur le panoccitan (cf. Mathy 2017), nous pouvons mettre en lumière l’implication de notre identité linguistique. En effet, en parlant du panoccitan, nous parlions, dans une certaine mesure, du wallon et de notre propre rapport à ce dernier. Par ailleurs, nous avons mis en jeu une double identité : une identité de scientifique, en construisant l’objet discours des locuteurs du panoccitan ; et une identité de locuteur, attendu qu’en étudiant le panoccitan nous avons engagé notre identité linguistique qui, spéculairement, renvoie à notre objet d’étude. Notre identité linguistique n’est donc pas simplement construite sur la pratique langagière concrète, mais sur un univers discursif qui entoure tant la langue que nous parlons que les autres langues et les autres pratiques linguistiques, indépendamment de si nous les parlons effectivement ou non.
3 Champ agonistique de l’identité : triple identité, triple altérité
Cet univers discursif nous paraît se construire comme un champ agonistique structuré par des altérités constitutives de notre identité linguistique. Pour nous en rendre compte, revenons sur le terme de francophone de Belgique (cf. Francard 1993 ; Francard 1998 ; Francard, Lambert & Berdal-Masuy 1993). Cette manière de nous qualifier en tant que locuteur est limitée : le fait que nous parlions le français en Belgique n’épuise aucunement la richesse de notre identité linguistique. Ce n’est, in fine, qu’un aspect de l’identité des locuteurs en fonction des diverses situations qui se superposent et s’intriquent. Par ailleurs, et conséquemment, l’identité idéaltypique dite du francophone de Belgique recouvre une pluralité d’identités et homogénéise des objets distincts. Ainsi, l’identité francophone de Belgique n’est pas l’identité wallonne, qu’il faut distinguer d’une identité wallonophone, qui n’est pas réductible à une identité francophone de Wallonie, qui, elle-même, est à distinguer de l’identité d’un francophone de Wallonie avec un ancrage identitaire dans le wallon ou de l’identité d’un francophone de Wallonie sans ancrage identitaire dans le wallon, et ainsi de suite. En d’autres termes, pour rendre compte de l’épaisseur de l’identité d’un locuteur donné, il faut la considérer en la situant dans une histoire personnelle, géolinguistique et familiale. Ces histoires doivent s’envisager comme des entités discursives, des imaginaires, des récits et des contre-récits qui peuvent se déployer tant dans la sphère familiale, scolaire, médiatique et ainsi de suite. Dans cette perspective, nous proposons d’envisager notre identité linguistique en tant qu’elle s’inscrit dans un univers discursif que nous qualifiions précédemment d’agonistique, attendu qu’il est structuré par un conflit entre notre identité et des altérités linguistiques idéalisées et réifiées.
Ces altérités sont la langue française comme hégémon, la langue wallonne comme triple objet contrarié et la langue néerlandaise comme antagonisme linguistique. Concernant la langue française, il apparaît que nous vivons cette dernière comme un contraste entre la vraie langue française, comme hégémon linguistique, et la langue française parlée en Belgique, nécessairement marquée – du moins, dans notre imaginaire discursif. Cette altérité produit par ailleurs une insécurité linguistique largement documentée (cf. Francard 1993 ; Francard, Lambert & Berdal-Masuy 1993). En outre, cet écart entre la langue française hégémonique et notre pratique réelle produit une discrimination linguistique objectivable qui porte sur la variation phonétique (cf. Blanchet 2018) ou sur des usages lexicaux marqués et considérés comme des belgicismes, à bannir. Dans la perspective auto-ethnographique que nous mobilisons, nous pouvons rapporter deux expériences et les mettre en regard avec la littérature scientifique. Notre première expérience de collusion avec la norme est une expérience scolaire ou, plus précisément, universitaire. Lorsque nous avons rejoint l’université, quittant ce faisant la campagne pour la ville, nous avons pris conscience, dans un contexte de violence symbolique prégnant, que certains des mots n’étaient pas propres à la langue française, ni même des belgicismes, mais des mots issus du wallon. Par ailleurs, lors de nos premiers stages professionnels afin de nous former au métier d’enseignant, nous avons vu l’usage de belgicismes sanctionnés comme des erreurs linguistiques. Cette double expérience est constitutive de notre insécurité linguistique et d’un sentiment d’altérité à la langue française dont nous n’avions jusqu’alors aucun sentiment de distance. Cette expérience illustre, de façon paradigmatique, les travaux sur la discrimination linguistique (cf. Blanchet 2018) ou sur les représentations des enseignants, notamment sur la perception des belgicismes, en contexte d’enseignement langue première et langue seconde (cf. Defays & Meunier 2015).
La seconde altérité que nous pouvons identifier est la langue wallonne. Notre rapport à cette langue peut s’entendre dans une triple perspective : comme un objet communicationnel, propre à des reconstructions spécifiques – comme le wallon refondu (cf. infra) ; comme un objet linguistico-littéraire qui consiste en l’ensemble des parlers wallons, dans toute leur variété, tout en répondant néanmoins à une certaine pureté normative ; et enfin, comme un objet empirique, le wallon tel qu’il est concrètement encore parlé et tel qu’il structure les pratiques réelles des locuteurs dont il s’agit de la langue maternelle. Ce wallon empirique, par opposition au wallon communicationnel (propre à des pratiques modernes) et linguistico-littéraire (propre à une réification épistémique), qui est la langue de nos grands-parents, subsiste par des situations de sublégalités (cf. Barbéris 1999), notamment folklorique ou toponymique. Aussi, dans une perspective émotionnelle et affectuelle, nous avons cherché à parler le wallon, précisément parce que nous l’associions à une histoire familiale et à un territoire géolinguistique spécifique. Or, lorsque nous avons commencé à étudier le wallon à l’université, une double altérité s’est manifestée. Premièrement, il est apparu que cet intérêt pour le wallon générait des jugements épilinguistiques axiologiques de la part de nos pairs, qui manifestaient à la fois un mépris de classe et une glottophobie normalisée. Deuxièmement, cette approche dialectologique, qui aurait dû, épistémologiquement, nous approcher du wallon empirique puisqu’il s’agissait, notamment, d’étudier les pratiques des locuteurs encore actifs, charriait, en-deçà du discours métalinguistique, une norme linguistique et, avec elle, la norme sociale – qui paraît consubstantielle au contexte curriculaire et scolaire dans lequel nous apprenions alors le wallon. Nous étions, en fait, confronté à la réification linguistico-littéraire. A titre d’exemple, nous avons en effet étudié, dans le cadre scolaire, un poète wallon local dont la langue fut jugée trop peu pure pour être d’intérêt : le wallon en question contenait des lexèmes français, des éléments de conjugaison français, en sus orthographiquement fautifs et, de surcroit, n’était pas transcrit en Feller[1] – graphie inexistante à l’époque du locuteur. Cette violence symbolique a marqué notre abandon d’une formation universitaire sur le wallon. Enfin, concernant le wallon communicationnel, à savoir la reconstruction d’un wallon unifié, appelé wallon refondu, souvent dans une perspective identitaire, nous n’avons aucun rapport affectuel avec ce dernier et n’avons jamais eu aucun désir d’un usage communicationnel du wallon qui nous paraît, à bien des égards, de l’ordre du simulacre.
La troisième altérité que nous pouvons observer est relative à la langue néerlandaise. Recontextualisons la situation géolinguistique de la Belgique, souvent qualifiée de laboratoire linguistique, voire de radeau de la méduse (cf. Francard 1995). La Belgique compte trois langues officielles et trois régions sans exacte superposition : la Wallonie (qui parle, principalement, le français et l’allemand) ; Bruxelles (le français et le néerlandais) ; et la Flandre (néerlandais) – hors cas spécifiques (à savoir les communes à facilités). Nous constatons que nous n’avons pas un sentiment d’altérité spécifique relativement à la langue allemande, contrairement au néerlandais. Cette différence est significative en soi. En effet, ce sentiment d’altérité, au cœur de notre identité linguistique, s’est construit sur la base d’une altérité politique qui cristallise des conflits de récits hégémoniques et de contre-récits propres aux conflits linguistiques en Belgique. L’imaginaire d’une langue wallonne mise en péril à cause de la langue française, cependant que le néerlandais (dans toute sa variation diatopique) a, non seulement, survécu, mais en s’opposant, en sus, au français, a participé à cette construction oppositive. L’antagonisme politico-linguistique entre francophone et néerlandophone est devenu une altérité linguistique intériorisée par le locuteur que nous sommes. Autrement dit, la langue néerlandaise, que nous ne parlons pas, est pourtant constitutive de notre identité, en tant qu’il s’agit d’une construction discursive qui implique de se positionner par rapport à des ‘autres’.
4 Conclusion : L’identité, entre performation rhétorique et mobilisation agentive
Ce bref parcours exploratoire nous permet de conclure sur une dernière piste de lecture. Dans la perspective que nous développons, l’identité et notre rapport à la langue sont certes expérientiels, mais aussi et surtout discursifs. Dans une perspective expérientielle, nous pourrions nous interroger sur le vécu linguistique : ne s’agit-il que de contraintes ? Ces altérités et l’identité qui en retourne ne produisent-elles que des insécurités linguistiques, des conflits affectuels et des rapports antagonistes ? Ou, au contraire, dès lors que nous nous situons dans un horizon discursif, il devient possible de jouer avec cette identité et les discours qui s’y rapportent ? Dans quelle mesure l’identité linguistique ne peut-elle pas s’envisager comme une performation rhétorique qui permet une mobilisation agentive des différentes altérités dont nous discutons ? L’altérité par rapport au français hégémonique peut être mobilisée à des fins rhétoriques : jouer sur l’accent ou sur les belgicismes afin de produire un éthos montré spécifique ou, de façon complémentaire, dire de soi que l’on est dans cette position dominée afin de produire des effets rhétoriques d’ordre éthotique ou pathique, sont des possibilités offertes dans une perspective performatrice.
Autrement dit, si la langue française n’est jamais parlée de façon neutre, en tant que locuteur nous pouvons mobiliser notre maitrise de la variation pour produire des effets rhétoriques. De façon similaire, la langue wallonne ne sera jamais appropriée, mais en tant que locuteur nous pouvons médier un nouveau rapport par la production scientifique ou par le travail littéraire – dont ce travail est déjà une illustration. La langue néerlandaise ne sera jamais perçue sans jugement politico-épilinguistique, mais en tant que locuteur nous pouvons mobiliser les affects comme motivation intrinsèque pour son apprentissage. Plus qu’une consubstantialité psychocognitive de la langue, l’identité devient un rôle – constitué par les discours – dont le locuteur peut précisément s’emparer dans une perspective agentive afin de produire des effets dans une situation de communication spécifique. Ces effets peuvent s’entendre d’une façon rhétorique : les éléments constitutifs de l’identité linguistique, qui permettent d’assigner le locuteur à telle ou telle identité, sur la base d’un construit sociodiscursif, deviennent des leviers rhétoriques sur lesquels peut agir le locuteur précisément pour faire reconnaître une identité donnée dans un contexte donné, à des fins d’effectivité communicationnelle et d’appréhension expérientielle – dont l’auto-ethnographie a pu nous donner un aperçu.
Références bibliographiques
Auchlin, Antoine (2016). « L’expérience du discours : Comment et pourquoi y accrocher son attention ? », in : Messmer, Heinz & Kim Stroumza (éds.), Langage et savoir-faire : Des pratiques professionnelles du travail social et de la santé passées à la loupe. Genève, Éditions ies, 113‑145.
Barbéris, Jeanne-Marie (1999). « Analyser les discours : Le cas de l’interview sociolinguistique », in: Calvet, Louis-Jean & Pierre Dumont (éds.), L’enquête sociolinguistique, Paris, L’Harmattan, 125-148.
Blanchet, Philippe (2018). « Entre droits linguistiques et glottophobie, analyse d’une discrimination instituée dans la société française », Cahiers de la LCD, 7 (2), 27‑44.
Defays, Jean-Marc & Déborah Meunier (2015). « Cachez cette erreur que je ne saurais voir ! », Pratiques. Linguistique, littérature, didactique [en ligne], 167‑168.
Francard, Michel (1993). « Trop proches pour ne pas être différents. Profils de l’insécurité linguistique dans la Communauté française de Belgique », in Francard, Michel (éd.), L’insécurité linguistique dans les communautés francophones périphériques, Leuven, Peeters, 61‑70.
Francard, Michel (1995). « Nef des Fous ou radeau de la Méduse ? Les conflits linguistiques en Belgique », LINX 33 (2), 31‑46.
Francard, Michel (1998). « La légitimité linguistique passe-t-elle par la reconnaissance d’une variété „nationale“ ? Le cas de la communauté française de Wallonie-Bruxelles », Revue québécoise de linguistique 26(2), 13‑23.
Francard, Michel, Joëlle Lambert & Françoise Berdal-Masuy (1993). L’insécurité linguistique en Communauté française de Belgique, Bruxelles, Service de la langue française – Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Gillot, Pascale (2013). « Pour une théorie non subjectiviste de la subjectivité : Jacques Lacan relu par Michel Pêcheux », Savoirs et clinique 16 (1), 36‑46.
Klinkenberg, Jean-Marie (2015). La langue dans la cité : Vivre et penser l’équité culturelle, avec préface par Bernard Cerquiligni, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Lahire, Bernard (2019). Dans les plis singuliers du social : Individus, institutions, socialisations, Paris, La Découverte.
Maingueneau, Dominique (1992). « Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours », Langages 105, 114‑125.
Mathy, Adrien (2017). La reconstruction identitaire de l’occitan sur le web : Un cas de planification (épi-)linguistique ? Analyse du discours des locuteurs. Présentation : Journée d’études sur le Traitement des Sources Galloromanes (TraSoGal), édition 2017, Liège, Belgique, in: <https://hdl.handle.net/2268/212331> [17.03.2025].
- Système de transcriptions pour les dialectes wallons, inventés par Jules Feller, linguiste belge, dans les années 1900. Le wallon refondu repose, par ailleurs, sur un système autre qui ne cherche pas à retranscrire phonétiquement les dialectes wallons, mais à proposer une écriture unique pour tous les wallons. ↵