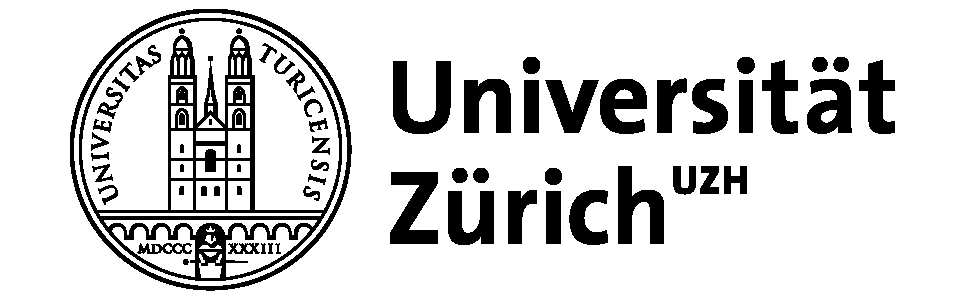Identité, langue et territoire : Claude Gauvreau et le bien commun
Astrid Novat
Université de Montréal / Université de Bourgogne
Abstract: When it comes to exploring the interweaving of language and identity, Quebec literature offers a unique field of investigation. As in other so-called minor literatures, language here is profoundly shaped by a high degree of deterritorialization. During the Quiet Revolution in particular, the works of writers took on a role of collective expression, one that aimed to foster an active solidarity. For many, this entailed reinforcing the idea of a homogeneous Quebec community, defined both ethnically and linguistically. However, others felt this approach risked entrenching a narrow regionalism. This tension is especially evident in the case of poet and playwright Claude Gauvreau, who views artistic creation as a means to delve more deeply into the foundations of community—namely, the common good.
c
Keywords: Claude Gauvreau; Bien commun; Québec; Territoire; Hétérolinguisme
1 Introduction
L’imbrication politique de la question linguistique au Québec et des questionnements identitaires qui en résultent ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Comme l’explique Lise Gauvin dans son ouvrage Langagement. L’écrivain et la langue au Québec, dès les origines de la littérature au Canada, les écrivains font état d’une surconscience linguistique. Celle-ci est causée par les « relations […] conflictuelles – ou tout au moins concurrentielles – qu’entretiennent entre elles deux ou plusieurs langues » (Gauvin 2000 : 8), en l’occurrence, entre le français du Québec et le français de France métropolitaine mais aussi entre le français et l’anglais dont le statut de langue officielle du Québec n’est abrogé qu’en 1974, au moment de l’adoption de la loi 22. Si l’on remarque, à compter des années 1970, une certaine lassitude à l’égard de la « conscription obligatoire des écrivains au grand Texte québécois » (38), la littérature des deux décennies précédentes est au contraire façonnée par de nombreuses revendications à caractère identitaire. En effet, en « [p]renant conscience de l’état de domination et de demi-colonialisme dans lequel se trouve alors la société québécoise, [l]es écrivains perçoivent la dégradation de leur langue comme un effet de cette domination » (210). Ces derniers s’engagent donc, à travers la pratique de l’écriture, à dénoncer l’absence de prise en charge de la question linguistique par l’État et à donner au français un statut de langue véhiculaire.
Du côté des dramaturges, la question linguistique s’arrime à un désir de se doter d’une dramaturgie nationale. Dans un discours intitulé « Pour un théâtre national et populaire » prononcé en 1949 par Gratien Gélinas, ce dernier invite les dramaturges à produire des pièces dans lesquelles ses contemporains pourraient enfin se reconnaitre. Cette reconnaissance passe évidemment dans un premier temps par la mise en scène de décors familiers, des univers ruraux comme le Saint-Anicet de Tit-Coq (Gélinas, 1948) puis urbains comme le Montréal de Zone (Dubé, 1953). Cependant, pour Gélinas, une communion parfaite entre scène et salle ne peut être envisagée que si les comédiens parlent la même langue que celle du public. Selon lui, « le théâtre [est] toujours d’abord et avant tout national, puisqu’il est forcément limité par sa langue » (Gélinas 1949). Bien que ce propos n’ait pour Gélinas aucun rapport avec le nationalisme politique, certains dramaturges jugent qu’une telle approche de la création dramatique ne contribuerait qu’à renforcer le « complexe tentant du colonisé » (Gauvreau 1978 : 29). C’est notamment le cas du poète et dramaturge Claude Gauvreau (1925-1971), lequel aspire au contraire à délaisser cette conception territoriale de la création au profit d’une plus grande ouverture sur le monde. Pour ce signataire du manifeste Refus global (1948) fermement opposé à toute forme de nationalisme, il s’agit de s’interroger plus en profondeur sur ce qui constitue le fondement d’une communauté, c’est-à-dire le bien commun. C’est précisément ce questionnement qui semble être à l’origine de Le Rose Enfer des animaux (1958), une pièce d’inspiration surréaliste dans laquelle Gauvreau propose un certain nombre de pistes de réflexion sur la question nationale québécoise. Il s’agira donc de montrer dans quelle mesure celles-ci s’érigent en alternative à une approche essentialiste de l’identité québécoise, laquelle serait fondée sur une identification territoriale et une approche monolithique de la langue. Pour ce faire, il convient premièrement d’aborder la genèse de ce projet qui puise son origine dans un débat autour du nationalisme. Celui-ci apporte un éclairage intéressant à la façon dont Gauvreau articule le rapport entre langue, identité et territoire, ce qui nous amènera, dans un second temps, à nous intéresser à l’approche culturelle du fait géographique et à la question linguistique dans une perspective géo- et sociopoétique.
2 Genèse d’un projet et position à l’égard du nationalisme
L’examen de la correspondance de Claude Gauvreau tend à indiquer que ses nombreux échanges avec le peintre Paul-Émile Borduas ont nourri l’écriture de Le Rose Enfer des animaux. La pièce est mentionnée pour la première fois dans une lettre datée de janvier 1958. Le dramaturge informe son correspondant de la progression de son écriture à plusieurs reprises et, le 3 novembre de la même année, Borduas annonce finalement avoir « reçu la “machine à décerveler” ». Également qualifiée de « grand “lavage de cerveau” » (Borduas 1997 : 1020), Le Rose Enfer des animaux ne semble pas tout à fait convaincre le peintre qui formule à son égard une certaine réserve. Il écrit notamment le propos suivant :
[J]e comprends mal votre défense d’un passé déjà loin. Plus exactement, cette défense me cache vos espoirs en l’avenir : en cet avenir qui m’intéresse toujours plus que le passé. Je départage mal les possibles de l’impossible, le personnel de l’impersonnel, les complexes dus aux phases anciennes de notre histoire d’un présent unifié qui monte. Je crus reconnaître des fixations, des partis pris désastreux, mais quelle générosité inventive, quel train du tonnerre, quel feu d’enfer, mon cher Claude (1020).
Si Borduas loue l’inventivité de son ami, il s’interroge toutefois sur sa posture politique. En effet, la pièce regorge d’allusions à la question nationale. Plusieurs répliques telles que « Le British est le vilain » (Gauvreau 1977 : 785) ou encore « La vie des coloniaux est une vie infernale !!! » (783) renvoient à la colonisation du Québec par l’Empire britannique tandis que d’autres comme « C’est lui Maurêze Deyplisséyion qui m’a vendue à l’Angleterre » (832) dénoncent explicitement la politique économique du gouvernement Duplessis. La réponse de Gauvreau ne se fait pas attendre, trois jours plus tard, soit le 6 novembre 1958, il écrit « Je ne crois pas défendre quelque passé que ce soit. Avec fièvre j’ai montré le négatif à côté du positif. Tant pis pour ceux qui ne s’y retrouvent pas ! » (Gauvreau 2002 : 204-206) Quelques mois après, il précise sa pensée et ajoute :
Le présent contient le passé, il est bon de s’en souvenir. Mais ce n’est pas pour affirmer le respect du passé que les quelques citations ont été incluses dans ma lettre précédente. Ces phrases me semblaient et me semblent des éléments éthiques d’une pensée révolutionnaire qui sont loin d’avoir épuisé leur actualité (210-215).
Le Rose Enfer des animaux ravive entre Gauvreau et Borduas une vieille querelle au sujet du sentiment national qui remonte au début des années 1950. Pour Borduas, il conviendrait de cesser d’évoquer « ces faits anciens » (Borduas 1997 : 1025), soit la dualité qui oppose les communautés anglophones et francophones du Canada afin de reconnaitre l’existence d’une « unité ethnique » (1026) et « psychique canadienne » (1027). Gauvreau attribue cette position à une évolution « vers un nationalisme canadien » à mettre sur le compte du « mal du pays » (Gauvreau 2002 : 206-210), le peintre ayant quitté le Québec pour les États-Unis en 1953 puis pour la France en 1955, suite au scandale provoqué par la parution de Refus global. L’inquiétude de Gauvreau vis-à-vis de la posture de Borduas est compréhensible. Cependant, Borduas ne cherche pas à justifier un sentiment national canadien ; il exprime plutôt sa lassitude face au ressassement du mythe du Canada français, qu’il considère comme un obstacle au développement d’un art canadien capable de s’épanouir en dehors des références politiques et culturelles. Selon lui, « [t]ant que les plus doués n’iront pas au-delà de certains préjugés nous ne serons intéressants qu’entre nous » (Borduas 1997 : 1027). Gauvreau adhère à ce dernier point. Cependant le postulat d’une unité canadienne, qu’elle soit ethnique ou psychique, lui apparait gênant. Dans sa lettre du 10 janvier 1959, il écrit à Borduas :
Même au temps lointain où j’étais Bloc Populaire, je ne pouvais déjà pas concevoir que le terme de « Canadien » n’était applicable qu’aux seules personnes de langue française ; ces préoccupations-là (quelle qu’en soit la solution préférée) me semblent vraiment archaïques. Les frontières géographiques sont à un degré moyen sans utilité pour moi présentement […]. Leur disparition définitive m’apparaît d’ailleurs comme souhaitable (« One Big World » : voilà un programme sympathique sur lequel je ne peux rien et dont j’espère que ceux qui y peuvent quelque chose s’occuperont). Je ne veux pas des catégories, je veux une harmonie dynamique (au moins pensée) avec tous les sensibles particuliers (206-210).
L’écriture de la pièce ayant été achevée quelques mois plus tôt, il n’est pas certain que la querelle autour de l’apparent nationalisme de Borduas ait contribué à modifier drastiquement le contenu de la pièce. Néanmoins, la réflexion dont fait part Gauvreau dans cette dernière lettre apporte un éclairage intéressant à la façon dont s’articule le rapport entre langue, identité et territoire dans Le Rose Enfer des animaux.
Il faut effectivement noter que pour le dramaturge, l’identité canadienne, c’est-à-dire québécoise, ne peut ni se définir par le seul usage de la langue française, ni par un rattachement au territoire et encore moins par une unité ethnique. La correspondance entre Gauvreau et Borduas ne contient cependant pas plus de précision sur ce qui constituerait le fondement d’une identité canadienne ou en quoi consisterait une application correcte du terme « Canadien » pour le dramaturge. Le choix du terme « Canadien » est par ailleurs lui-même parlant. En effet, le substantif a désigné « historiquement les colons de Nouvelle-France et leur descendance » et a été remplacé, au XIXe siècle, par l’appellation Canadien français qui désigne quant à elle « un francophone du Canada, par opposition à Canadien anglais » (Quirion, Chiasson & Charron 2017 : 150). Cette appellation sera elle aussi progressivement délaissée au profit du terme « Québécois », afin de marquer une « rupture significative avec les autres collectivités francophones du pays et avec la communauté anglophone » (150). Si le terme « Québécois » se généralise à compter de 1968, il faut toutefois signaler qu’il coexiste avec l’appellation « Canadien français » avant cette date et n’est privilégié qu’à compter de 1959. Comme le soulignent Jean Quirion, Guy Chiasson et Marc Charron dans leur article « Des canadiens français aux québécois : se nommer à l’épreuve du territoire ? », cette évolution linguistique est « intimement associée à la mise en discours progressive de l’identité québécoise » et marque le passage d’une identité qu’on qualifie de « canadienne-française » à une identité proprement « québécoise » liée à une « territorialisation de l’identité » (145). Celle-ci implique une « redéfinition des frontières mêmes à l’intérieur desquelles se développe et finit par se cristalliser cette identité » (144). Si le nationalisme canadien-français renvoyait au Canada français, qui englobe non seulement les francophones de la province du Québec mais également ceux des autres provinces comme ceux ayant émigré aux États-Unis, et n’avait donc pas vraiment « d’assise territoriale », « [l]’identité québécoise, quant à elle, suppose par définition un recentrement du projet national sur les frontières de l’État québécois », conduisant « implicitement à une rupture avec tous les francophones de l’extérieur du Québec » (144). Ainsi, comme l’écrit Yves Frenette (1998 : 168), cité par Jean Quirion, Guy Chiasson et Marc Charron :
Le territoire physique occupé par l’État du Québec se confond désormais avec le territoire mental de la nation, qui se traduit par un « nous les Québécois » dont sont plus ou moins exclus les francophones vivant à l’extérieur du Québec, perçus comme appartenant à une autre zone, canadienne ou américaine, donc à un gouvernement étranger.
Ce recentrement du projet national semble en partie responsable de la réticence de Gauvreau à employer le terme « Québécois », qu’il n’adoptera qu’à partir des années 1970. Ceci n’entraîne néanmoins aucun changement dans sa position politique. Dans un texte intitulé Réflexions d’un dramaturge débutant (1970), dans lequel on ne trouve aucune mention du terme « canadien » contre six occurrences du terme « québécois », le dramaturge affirme sans détour que « la valorisation prioritaire du régionalisme isolationniste est tout à fait niaise » (Gauvreau 1978 : 30). Il faut toutefois préciser que ce propos se présente comme la conclusion d’une réflexion plus large sur la nature de la langue parlée au Québec. Gauvreau dénonce les politiques linguistiques visant à la standardisation de la langue et à la suppression de ses spécificités culturelles, notamment certaines formes d’argot, qui auraient tendance à nuire à l’affirmation d’une identité collective uniforme. Outil d’homogénéisation du territoire et d’expression de la nation, en ce qu’elle renforce un sentiment d’appartenance, la langue participe ainsi du développement de ce que Benedict Anderson qualifie de « communauté imaginée », c’est-à-dire « une communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine » (Anderson 1996 : 19-20). Or, pour le dramaturge, l’affirmation d’une identité collective reviendrait à effacer la singularité de chaque individu, et par la même occasion, causer l’appauvrissement culturel « d’une nation accédant enfin à la maturité » (Gauvreau 1978 : 26). À ce sujet, l’un des dialogues de Le Rose Enfer des animaux est particulièrement parlant :
Arsène de Haucauman – Et l’identité ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
Prescott Diebulian – Cela veut dire que, par un comportement vu, deux attitudes se confondent au point que deux êtres distincts se mettent dans le même sac spontanément (Gauvreau 1977 : 811).
Une fois de plus, ce propos semble faire écho aux échanges entre Borduas et Gauvreau. L’affirmation d’une identité commune, qu’elle soit canadienne ou québécoise, nuit à l’épanouissement des êtres singuliers. Réflexions d’un dramaturge débutant confirme cette idée, dans la mesure où Gauvreau y annonce : « [u]ne civilisation exemplaire m’en semble une qui permettrait à une infinité d’unicités sans précédent et sans équivalent de naître et de proliférer » (Gauvreau 1978 : 27). Dans cette perspective, il s’agit moins de se rassembler autour d’une identité commune qui serait le fondement d’une communauté nationale que de prôner une démarche visant à nourrir une réflexion sur le commun, c’est-à-dire la « volonté et [la] capacité d’agir ensemble qui ont comme effet la constitution d’une communauté d’action ou de production » (Laval 2016). C’est précisément ce changement d’optique sur la question nationale qui oriente notre lecture de Le Rose Enfer des animaux.
3 Imaginer l’espace du commun
Dans la mesure où l’édification d’une identité québécoise se traduit dans le discours par une redéfinition des frontières à l’intérieur desquelles elle se développe, l’analyse du traitement de la question de l’identité territoriale dans Le Rose Enfer des animaux s’avère particulièrement intéressante. Contrairement aux autres pièces de Gauvreau, qui ne comportent que peu, voire aucune allusion à un espace référentiel, Le Rose Enfer des animaux propose un éclairage privilégié sur la vision du dramaturge en regard de cette question. En effet, la pièce comporte un nombre impressionnant de toponymes, soit environ une cinquantaine de noms de villes, de communes, d’îles, de quartiers, de rues, de places ou encore de sites archéologiques du continent américain, européen, asiatique et africain. Les didascalies initiales placent néanmoins l’action dans un lieu flottant, soit « un palais et son jardin attenant ». Seuls les arbres ont « quelque chose de gréco-romain dans la forme » (Gauvreau 1977 : 759). Sur cette cinquantaine de toponymes, deux seulement apparaissent en didascalies soit, « la rue Kungsgatan à Stockholm » (817) et « Puerco & Torrejon » (810), ces derniers étant deux formations géologiques du nord-ouest américain. Il s’agit ici moins de favoriser une identification territoriale qui s’appuierait sur une cartographie réaliste du monde que de faire de la géographie un objet de discours qui vient nourrir les répliques des personnages. Le dramaturge favorise une approche culturelle du fait géographique au détriment de l’approche structurelle, traditionnellement privilégiée par les géographes. Or comme l’explique Joël Bonnemaison, dans son article « Voyage autour du territoire » (1981 : 257),
L’espace culturel est un espace symbolique chargé d’affectivité et de significations : dans son expression la plus forte, il devient un territoire-sanctuaire, c’est-à-dire un espace de communion avec un ensemble de signes et de valeurs. L’ idée de territoire devient alors associée à celle de repliement et de conservation culturelle.
Contrairement à l’espace géographique, c’est-à-dire une étendue terrestre concrète, le territoire « fait appel à tout ce qui dans l’homme se dérobe au discours scientifique et frôle l’irrationnel : il est vécu, affectivité [et] subjectivité » (261). En effet, dans Le Rose Enfer des animaux, plusieurs des lieux mentionnés par les personnages semblent marqués par un fort degré d’affectivité, en particulier lorsque ceux-ci appartiennent au paysage urbain montréalais :
Andréa Lila – La Place d’Armes à cela ?
Domitien d’Olmansay – Un point de repère. De repaire (Gauvreau 1977 : 787).
Située dans le quartier historique du Vieux-Montréal, la Place d’Armes est l’une des plus anciennes places publiques de la ville, que l’un des personnages qualifie de point de repère. Loin d’être anodin, ce qualificatif renvoie à la fois à la fonction d’orientation attribuée au lieu, mais également à sa fonction symbolique, dans la mesure où il relève d’une actualisation subjective par l’individu. Le glissement sémantique qui s’opère par jeu d’homophonie souligne bien la façon dont l’identité territoriale s’organise autour de repères spatiaux. La Place d’Armes n’est plus dépeinte comme un simple repère spatial mais comme un abri voire un refuge, ce qui tend à mettre en évidence le lien qui s’établit entre l’individu et le paysage perçu comme territoire.
Un degré d’affectivité similaire est exprimé dans la réplique « Elle ne rêve qu’aux paysages de l’avenue Laval ; elle a vu le parc et elle s’en est imprégné le cœur » (801). L’avenue Laval traverse l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et constitue l’une des voies d’accès au parc du carré Saint-Louis, un lieu emblématique montréalais[1], en bordure duquel ont résidé de nombreux écrivains québécois dont Émile Nelligan, Gaston Miron ou encore Claude Gauvreau lui-même. Le carré Saint-Louis comme la Place d’Armes est à plusieurs égards assimilable à ce que Joël Bonnemaison qualifie de « géosymbole », soit un espace symbolique, « un lieu, un itinéraire, un espace, qui prend aux yeux des peuples et des groupes ethniques, une dimension symbolique et culturelle, où s’enracinent leurs valeurs et se conforte leur identité » (Bonnemaison 1981 : 249). Une telle perspective semble à première vue entrer en contradiction avec l’objectif de Gauvreau, lequel ne cherche pas à conforter un sentiment d’identification territoriale, bien au contraire. En effet, la dernière réplique est suivie de la réponse d’un personnage, soit « C’est à l’Italie qu’elle pense quand elle interroge dans son idiome les femmes et les jeunes filles corses ; à elle encore devant les horizons de Provence » (Gauvreau 1977 : 801). Le sujet des deux répliques est un mystérieux « elle » qu’il est impossible d’identifier en l’absence d’un antécédent clair. S’il peut s’agir d’une seule ou bien de plusieurs entités distinctes, la répétition du pronom entraîne une forme de télescopage entre l’Italie et le carré Saint-Louis. En dépit de leur absence de similitude sur le plan de l’espace structural ou objectif, ils coexistent sur le plan de l’espace culturel ou subjectif dans la mesure où, à échelle respective, l’Italie comme le carré Saint-Louis occupent une place de choix dans l’imaginaire littéraire. Comme « elle », le spectateur est invité à conjuguer ces deux espaces à priori inconciliables et à s’interroger sur la façon dont la littérature modifie sa perception des lieux.
Pour Gauvreau, l’espace est à envisager comme le produit d’une construction mentale collective. Il émerge à la confluence de ses différentes représentations, qu’elles soient autochtones ou allogènes, et échappe, dans cette perspective, à la logique du territoire. Il est donc intéressant de noter que plusieurs des lieux évoqués dans la pièce apparaissent, explicitement ou implicitement, au sein de citations comme c’est le cas dans l’exemple suivant :
Domitien d’Olmansay — « De grands chevaux de pourpre erraient, sanguinolents, Par les célestes turfs, et je tenais, tremblants, Tes doigts entre mes mains, comme un nid d’oiseaux blancs. » […]
Prescott Diebulian — Réminiscence…
Erthulia Gohiaz — … de Nelligan (Gauvreau 1977 : 764-765).
Le personnage cite un extrait du poème « Jardin sentimental » d’Émile Nelligan. S’il n’est explicitement question d’aucun lieu, les spectateurs familiers de l’œuvre de ce poète québécois ne sont pas sans savoir qu’il est ici question d’une rêverie déclenchée par le souvenir d’une maison, qui n’est autre que celle de Nelligan, située sur l’avenue Laval. Le carré Saint-Louis, comme les autres lieux dont il est question dans Le Rose Enfer des animaux, échappe à toute logique de propriété. Il se conçoit plutôt comme la somme des images produites par une variété de subjectivités, parmi lesquelles tout spectateur qui souhaiterait participer à l’entreprise, et devient dès lors, un véritable bien commun.
4 La langue : un bien commun créatif
Si elle était initialement envisagée comme un outil d’homogénéisation du territoire, la langue refuse de se présenter comme un ensemble monolithique dès le moment où l’espace cesse d’épouser les contours de la nation. En effet, le recours à l’intertexte n’a pas pour unique vocation de renégocier l’approche de l’espace, il permet également de souligner que, comme ce dernier « “la langue” est toujours déjà utilisée par d’autres et fondamentalement partagée » (Suchet 2014 : 159). Dans Réflexions d’un dramaturge débutant, Gauvreau exprime sa position en regard de la langue parlée au Québec :
Québécois libérés ou libérables bientôt, nous avons autant le droit de fournir notre apport créateur particulier au français dit universel que les Etats-Uniens libérés ont fourni et fournissent le leur à l’anglais dit universel; cet apport peut s’imposer mondialement, entre autres, par la production d’œuvres créatrices concurrentielles qualitativement au niveau international (Gauvreau 1978 : 30).
Le Rose Enfer des animaux constitue à certains égards une mise en œuvre du projet gauvréen. Contrairement aux autres pièces du dramaturge, on y trouve un grand nombre de québécismes comme « tuque » (Gauvreau 1977 : 763), ou encore des sacres comme « ciboires » (821) ou « un hostie de coup de poing » (775). Néanmoins, les personnages emploient également d’autres variations diatopiques telles que l’helvétisme « Châble » (800) ou le francisme « con » (797), relativement inusité au Québec avant les années 1960. La langue française est ainsi moins présentée comme un ensemble homogène que comme un continuum linguistique. Plus encore, le dramaturge s’attèle à employer certains termes désuets, dont « Aumaille » (772), « Houssage » (833) ou « Mazagran » (789) mais aussi des locutions latines telles que « Jucomditas Crucis » (812). À ces variations diachroniques s’ajoutent également des variations diastratiques dans la mesure où les personnages emploient de nombreux termes techniques utilisés en botanique (« Amplexicaule ») (783), en zoologie (« Lucifuge ») (790), en médecine (« Exophtalmique ») (833), en géologie (« Nummulitique ») (783), en droit (« Nuncupatif ») (776) ou encore en géométrie (« Obtusangle ») (809). Néanmoins, ils font également usage d’une langue plus populaire comme en témoigne la présence des nombreux sacres et jurons déjà évoqués plus haut ou bien d’expressions argotiques telles que « Chinage » (782) ou « bouif » (802). Ainsi, comme l’écrit Myriam Suchet à propos d’une œuvre issue de son propre corpus, Gauvreau quitte « le référentiel normé du “standard” pour un relativisme absolu où il n’y a plus de déviances ni de variantes mais seulement des variations inhérentes. Tandis qu’une “variante” n’existe que par rapport à un “invariant”, la “variation” est libérée de l’étalon de la norme » (SUCHET 2014 : 114). Si Gauvreau n’est pas l’unique dramaturge à proposer une réflexion sur l’hétérogénéité de la langue française, il faut toutefois noter que ses contemporains ont plus généralement une approche mimétique de la parole scénique. En effet, dans son discours « Pour un théâtre national et populaire », le dramaturge Gratien Gélinas expose sa vision du théâtre qui selon lui « sera toujours d’abord et avant tout national, puisqu’il est forcément limité par sa langue » (Gélinas 1949). Ce discours, qui annonce l’avènement de la période réaliste du théâtre québécois, encourage les dramaturges à produire des pièces dans lesquelles la langue assurerait une fonction spéculaire. Il s’agit ainsi de permettre au spectateur d’entendre sur scène une langue authentiquement québécoise, qui assumerait pleinement sa différence avec le référentiel normé du « standard ». Gauvreau s’oppose cependant fermement à l’esthétique réaliste dans la mesure où celle-ci contribuerait à faire du théâtre québécois un art strictement régional. Le recours à la spécificité linguistique québécoise n’aurait donc de sens qu’à la seule condition de venir nourrir le « français dit universel » (Gauvreau 1978 : 30). Dans cette perspective, la langue est envisagée comme un bien commun créatif dans la mesure où chaque locuteur est en mesure de participer à l’enrichissement de la langue.
Le français employé dans Le Rose Enfer des animaux est marqué par l’emploi de nombreux néologismes qui constituent par ailleurs le fondement de la langue poétique employée par le dramaturge : l’exploréen. S’il n’est pas aisé de définir en quelques mots ce projet poétique de grande envergure, il convient tout de même de souligner que l’exploréen n’est pas une langue distincte du français dans la mesure où elle en constitue plutôt le prolongement. Français courant et exploréen se comprennent ainsi comme deux pôles d’un même continuum linguistique. Dans sa correspondance avec Jean-Claude Dussault, qui se présente à plusieurs égards comme un véritable art poétique, Gauvreau explique que sa poésie repose sur l’image, qu’il définit comme « la mise en confrontation de n’importe quels éléments verbaux : syllabe, mot abstrait, mot concret, lettre, son, etc » (Gauvreau & Dussault 1993 : 293). Parmi les quatre types d’images qu’il distingue, « l’image transfigurante » (297) apporte un éclairage intéressant sur Le Rose Enfer des animaux. Gauvreau la présente comme un équivalent aux mots valises et en emploie un certain nombre dans la pièce, dont « Hirudiculte » (Gauvreau 1977 : 771), qui semble être un mélange entre hirondelle, ridicule, érudit et culture mais aussi « Épormyablement » (829), un terme créé sur la base d’époustouflant et incroyable, et qui apparait par ailleurs dans le titre d’une autre pièce du dramaturge, La Charge de l’orignal épormyable. Un autre exemple serait « Cistercitron » (807), qui semble être un amalgame de « sister », citron et de Cicéron. Or il convient de noter que le dramaturge s’appuie ici sur un idiome étranger, soit l’anglais, pour former cette image. De manière similaire, il crée le terme « Tomahawkée » (836) issu de la transformation du substantif algonquin « tomahawk » en participe passé français grâce à un procédé de dérivation exocentrique. L’incorporation d’idiomes étrangers à la langue poétique exploréenne permet d’intégrer ces derniers à un continuum linguistique plus vaste qui serait celui du français, ou, plus précisément, celui d’une langue universelle, étant donné que pour les personnages : « Le bilinguisme est préférable à l’unilinguisme et toute langue universelle est une possibilité flagrante d’authenticité ! » (827). Bien que l’on puisse d’emblée discuter des limites de cette démarche, en particulier en regard de la question autochtone et de la disparition des langues provoquée par l’impérialisme linguistique, il faut toutefois souligner que la seule mention d’un idiome autochtone dans une pièce datée de 1958 est tout à fait insolite. Cependant, il est ici moins question d’universalisme, entendu comme un désir d’uniformisation, que d’universalité, c’est-à-dire ce qui concerne le monde entier et donc le commun. De fait, pour les personnages, « Tous les langages sont authentiques. Chaque être est un langage. Chaque langage ambitieux est respectable et digne d’amour » (827). Dans cette perspective, l’universel tel qu’il est présenté dans Le Rose Enfer des animaux semble venir préciser la notion de bien commun. Il ne s’agit pas de venir supplanter des langues préexistantes par l’instauration d’une nouvelle langue universelle, mais d’aborder chaque langue, incluant chacune de ses variantes, comme un réseau d’infinies possibilités poétiques lesquelles servent d’appui au travail créateur. La langue, comme l’espace, échappe à toute logique de propriété. Elle est la somme des images, pour reprendre le terme de Gauvreau et faire écho à notre propos précédent, produites par une variété de subjectivités.
Contrairement à ce que redoutait Borduas, Gauvreau est résolument tourné vers l’avenir. En effet, pour le dramaturge, il est moins question de s’appesantir sur les événements historiques ayant mené à une situation de demi-colonisation comme semble le penser le peintre, que de s’interroger sur la conséquence de ces événements en regard du développement de la littérature québécoise. Rapidement reléguée au rang des littératures dites mineures, cette dernière se voit chargée de produire une forme de solidarité active afin de pallier le manque de prise en charge de la question nationale par l’État. Or, pour le dramaturge, un tel projet aurait pour conséquence de réduire la littérature produite au Québec à un art régionaliste replié sur lui-même et à renforcer une approche essentialiste de l’identité québécoise. Le Rose Enfer des animaux se présente ainsi comme une tentative de réponse au discours nationaliste, en ce qu’il propose une alternative à une conception de la communauté fondée sur l’effacement de la singularité de ceux qui la composent. Il serait ainsi moins question de se rassembler autour d’une identité commune laquelle serait fondée sur une identification territoriale et linguistique que de s’interroger plus en profondeur sur ce qui constitue le fondement d’une communauté, c’est-à-dire le bien commun. Dans cette perspective, Gauvreau opte pour une approche plus universelle de l’espace et de la langue qu’il propose d’envisager comme le produit de constructions mentales collectives. Bien que ce modèle de pensée comporte un certain nombre de limites, en particulier en regard de la question autochtone, Le Rose Enfer des animaux engage son spectateur à remettre en question la notion même d’identité nationale.
Références bibliographiques
Anderson, Benedict (1996 [1983]). L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte.
Bonnemaison, Joël (1981). « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique 4, 249-262.
Borduas, Paul-Émile (1997). Écrits II. T2 (Correspondance 1954-1960), Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Frenette, Yves (1998). Brève histoire des Canadiens français, Montréal, Boréal.
Gauvin, Lise (2000). Langagement. L’écrivain et la langue au Québec, Montréal, Boréal.
Gauvreau, Claude (1977). «Le Rose Enfer des animaux [1958]», in : Gauvreau, Claude, Œuvres créatrices complètes, Ottawa, Éditions Parti pris.
Gauvreau, Claude (1978). « Réflexions d’un dramaturge débutant : 1970 », Jeu 7, 20-37.
Gauvreau, Claude (2002). Lettres à Paul-Émile Borduas, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Gauvreau, Claude & Jean-Claude Dussault (1993). Correspondance 1949-1950, Montréal, Éditions de l’Hexagone.
Gélinas, Gratien (1949). « Pour un théâtre national et populaire », in : <https://www.biblisem.net/etudes/gelithea.htm> [07.04.2024].
Laval, Christian (2016). « “Commun” et “communauté” : un essai de clarification sociologique », in : <http://journals.openedition.org/sociologies/5677> [02.04.2024].
Quirion, Jean, Guy Chiasson & Marc Charron (2017). « Des canadiens français aux québécois : se nommer à l’épreuve du territoire ? », Recherches sociographiques 58 (1), 143-157.
Suchet, Myriam (2014). L’Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris, Classiques Garnier.
- Fait révélateur de la valeur symbolique accordée à ce haut lieu du patrimoine culturel montréalais, le carré Saint-Louis a justement été choisi par les écrivaines et écrivains du Québec de l’UNEQ comme sujet d’exposition présenté par Québec Édition au Salon du livre de Genève en 2017. Les visiteurs ont été invités à visiter ce lieu, notamment la maison d’Émile Nelligan ou encore celle de Gérald Godin et de Pauline Julien, à travers une exposition immersive scénographiée par La Camaraderie. ↵