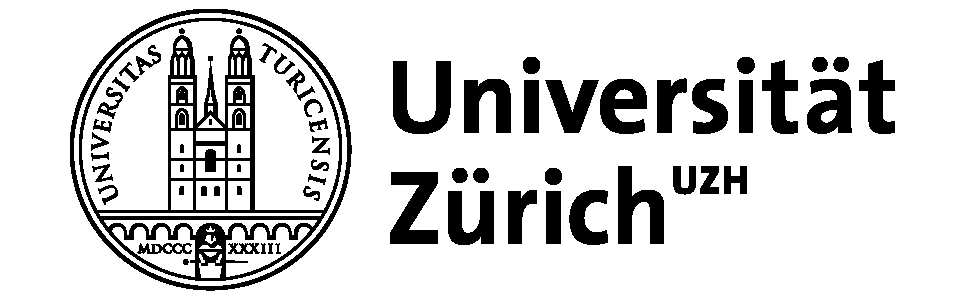Dire l’identité retrouvée au sein de la communauté déportée dans Mesure de nos jours de Charlotte Delbo
Sophie Hochuli
Université de Zurich / Université Paris-Saclay
Abstract: Mesure de nos jours is the final volume of the Auschwitz et après trilogy originally published in 1971 by Éditions de Minuit. Written by French resistance member Charlotte Delbo, this third volume delves into the destinies and fragments of the post-camp lives (« nos jours ») experienced by Charlotte Delbo and her fellow survivors. The text displays the challenges of individual and collective identity faced by those who endured the horrors of the concentration camp. The following pages aim to explore how the narrative’s polyphonic structure fosters a dialogue not only among different communities (“we”, “you”), but also among the individuals (“I”, “you”), and how this interplay enhances the process of re-individualization that unfolds throughout the work. Mesure de nos jours also sheds light on the crucial role of language and its different semantic processes in bridging not only the chasm between those who perished and those who survived (“we”), but also between the survivors and the collective of those who did not experience the camp (“you”).
c
Keywords: Charlotte Delbo; Mesure de nos jours; Auschwitz et après; littérature concentrationnaire, identité de survivant·e·s
1 Charlotte Delbo, résistante française
Charlotte Delbo, bien qu’elle n’ait pas été directement impliquée dans un réseau de la Résistance française pendant l’occupation allemande, était chargée de la transcription des écoutes de la Radio Londres et de la Radio Moscow. En 1942, elle est arrêtée avec son mari, Georges Dudach, par la police de Vichy et la Gestapo et conduite à la Prison de la Santé, où Dudach est fusillé. En 1943, elle est déportée à Auschwitz dans le fameux convoi du 24 janvier, puis transférée à Ravensbrück, un camp pour femmes et enfants, où elle est internée pendant 15 mois. À sa libération, en avril 1945, elle est l’une des 49 rescapées du convoi du 24 janvier. Peu après son retour en France, elle commence à mettre en mots ce qu’elle a vécu, donnant naissance à une trilogie intitulée Auschwitz et après. Les deux premiers volumes, publiés respectivement en 1965 et en 1970 aux Éditions de Minuit, témoignent de son vécu au camp et portent une voix qui exprime son expérience personnelle, tout en parlant au nom de tous ceux et toutes celles qui, comme elle, ont enduré les horreurs des camps de concentration nazis. L’un des enjeux majeurs de cette trilogie réside dans la reconfiguration de la mémoire par le texte, ainsi que dans la manière dont il engage le lecteur et la lectrice dans cette exploration. Au lieu d’adhérer strictement aux conventions du témoignage historique, l’autrice crée une œuvre poétique qui transcende les normes et les genres établis. En 1971 paraît le troisième tome intitulé Mesure de nos jours : après 25 ans passés à ‘survivre’ dans le monde des vivant·e·s, Charlotte Delbo retourne voir ses ancien·ne·s camarades rescapé·e·s[1] pour recueillir leurs souvenirs et échanger sur leur vie après le camp, afin d’en faire un livre avec leurs histoires (voir l’avant-propos dans Delbo 2018 : 7-10). C’est ce livre qui fera l’objet de nos réflexions.
2 Mesure de nos jours, témoignage personnel et collectif
Dans Mesure de nos jours, nous lisons la difficulté des survivant·e·s des camps de concentration de revenir à la vie. Cette recherche est soulignée par la structure du texte, mélangeant dans un rythme propre des poèmes, souvent regroupés en triades, et des passages en prose.
Peu après son premier témoignage en prose accompagné de trois courts poèmes, Delbo quitte l’espace personnel pour endosser une voix collective et représenter une diversité de voix de survivant·e·s : elle donne la parole à treize témoins qui deviennent, chacun à son tour, narrateur ou narratrice. Parmi ces témoins, il y a onze femmes, deux hommes (Jacques et Loulou), des Juifs et des non-Juifs, des communistes, des non-communistes, des ex-communistes. Chaque personnage a eu sa propre identité avant le camp et le récit nous expose la difficulté de retrouver cette identité-là après le camp. Les témoins de Delbo racontent leur réadaptation à la vie, une réadaptation parfois réussie, parfois échouée. Ce sont des récits de maladie, d’obsession, d’illusion et de folie, de divorce et de chagrin, mais également de mariage et d’enfants.
Dans les pages qui suivent, nous interrogerons la manière dont Mesure de nos jours s’empare de la question identitaire des survivant·e·s à travers un dispositif polyphonique à la fois littéraire et éthique, et nous découvrirons les modalités du langage pour transmettre l’expérience à ceux et celles qui n’ont pas vécu le camp.
2.1 Énonciation polyphonique – un geste éthique
L’organisation de Mesure de nos jours en treize témoignages différents nous révèle d’emblée l’énonciation polyphonique orchestrée par l’autrice-narratrice Charlotte Delbo. S’il s’agit ici d’un cas classique de polyphonie telle que théorisée par Mikhaïl Bakhtine[2], les voix mises en scène par le texte de Delbo sont, en l’occurrence, juxtaposées, ce qui leur confère un statut d’équivalence qui traverse la totalité de l’œuvre. Cette mise en équivalence peut être comprise comme un geste éthique, qui nous invite à reconnaître la pluralité des identités individuelles constituant l’identité collective des victimes survivantes du camp. Dans La littérature en suspens. Écritures de la Shoah, Catherine Coquio décrit la voix du témoin dans ce texte de Delbo comme se « démultipliant en plusieurs récitatifs » (Coquio 2015 : 255). Chacun de ces « récitatifs » est révélateur de la difficulté à vivre après le camp et de la confrontation avec un monde qui ne partage pas le même traumatisme. Dans son ensemble, le livre met au jour des identités brisées qui retrouvent leur individualité, ou du moins, qui s’y essayent, dans et à travers leur témoignage.
Les témoins dans Mesure de nos jours partagent tous et toutes leur appartenance à cette « communauté spectrale » (2011) des rescapé·e·s dont parle par exemple Anne Martine Parent dans le recueil Les Revenantes. Charlotte Delbo : La voix d’une communauté à jamais déportée (2011). Cette « communauté » est dite « spectrale » car ses membres sont hantés par les souvenirs des mort·e·s et les traumatismes du passé, même s’ils sont physiquement présents, et peut être rapprochée de l’idée du « spectre » (TLFi, en ligne) dans le sens physique du terme : le spectre est formé de plusieurs rayons et couleurs, c’est-à-dire, en l’occurrence, de plusieurs voix portant sur une même réalité. En effet, le « je » narrateur initialement uniforme de Charlotte Delbo, évolue, au fil des pages, vers un « nous » ‘multicolore’ pour ainsi dire, composé de plusieurs voix singulières, chacune dans le ton et la ‘couleur’ qui lui sont propres. Ce jeu polyphonique crée une totalité de voix, où chaque voix, tout en étant distincte, assume à son tour la totalité à laquelle elle appartient. C’est ainsi que le « nous » prend forme. « Être heureux, est-ce une question que nous nous posons, nous ? », formulera Gilberte (Delbo 2018 : 195) et Mado, qui se relie continuellement aux « spectres de nos compagnes » dans sa vie actuelle, déclarera : « Mon fils est leur fils à toutes » (Delbo 2018 : 207).
De plus, en donnant la parole à ceux et celles qui ont vécu la même horreur et connu à leur tour ceux et celles qui sont mort·e·s au camp, dont les noms sont évoqués dans les témoignages, Charlotte Delbo rend également justice à ceux et celles qui ne peuvent plus témoigner. Là où Giorgio Agamben voit l’impossibilité de communiquer depuis l’intérieur du camp à la place des mort·e·s, à la place du « non-homme » (Agamben 1998 : 32), Delbo ouvre donc cette possibilité en les inscrivant dans la parole survivante.
Au sein du jeu polyphonique mis à l’œuvre dans Mesure de nos jours, un principe de dialogue s’installe : celui-ci mobilise le savoir sur le passé et sur le présent et crée des croisements d’altérités (voir Ruffini 2014 : 215) à travers les différents niveaux diégétiques et la polyvalence des pronoms personnels. Un dialogue s’installe ainsi entre le « nous » communautaire et les ‘autres’, comme les « vous, les Parisiennes » (Delbo 2018 : 179), mais aussi entre la voix narrative « je » de chaque témoignage et le lecteur et la lectrice interpellé·e. Ce lecteur ou cette lectrice comprendra au fil des pages que le « tu » évoqué dans les différents récits désigne souvent l’autrice-narratrice Charlotte Delbo à qui s’adressent les témoins : « Je te passe les détails » (Delbo 2018 : 222), « Je te dis tout cela parce que toi tu le comprends » (Delbo 2018 : 209). Ainsi, les identités des narrateurs et narratrices se (re)construisent en interpellant supposément le ou la destinataire du texte (le lecteur ou la lectrice), mais surtout aussi à travers leur dialogue avec l’instance énonciatrice organisant le récit (Charlotte Delbo), ce qui confère à ces récits des airs de correspondance épistolaire.
Selon Dominique Rabaté, la voix narrative prend une nouvelle place dans la littérature de l’après-guerre. Dans le récit en particulier, cette voix cherche à résoudre la question du statut de la littérature, à savoir qu’elle est à comprendre comme sujet et objet, production et produit (voir Rabaté 1991 : 6-9). À l’instar de ce double statut sujet-objet de la voix, le statut des voix dans Mesure de nos jours soulève la question de savoir si l’on peut aller jusqu’à parler d’une « désubjectivation » des témoins, comme le suggère Martine Delvaux dans son article « Charlotte Delbo : l’amitié » (2011 : 221). Si l’instance narratrice se démultiplie en plusieurs voix pour permettre une représentation inclusive et partagée de l’expérience concentrationnaire et celle de la vie d’après, qu’en est-il alors du statut identitaire de ces différentes voix ? Les voix se « désubjectivent »-elles pour ne partager que l’expérience de leur vécu ? Nous tenterons d’y répondre dans le paragraphe suivant.
2.2 L’identité retrouvée : le « je » dans le « nous »
Là où « l’image de soi » (Oppenheim 2009 : 75) était effacée pendant la déshumanisation vécue dans les camps, là où « le sentiment d’identité [était] menacé par une réalité déstructurante » (Waintrater 2000 : 207) et où les identités individuelles se fondaient dans un seul et large corps collectif de détenu·e·s, les identités des témoins parviennent peu à peu, après le camp, à reconstruire la réalité autour d’elles et à retracer leurs propres contours. En effet, la multitude de « je » parlants, restant partie intégrante du « nous », commence désormais à donner forme aux identités retrouvées, non plus dominées par une seule voix, mais laissant place à une discussion entre des voix équilibrées. Ces identités résolvent la confusion entre soi et les autres, se réindividualisent, tout en gardant le lien profond qui relie ceux et celles qui ont fait et continuent à faire l’expérience de l’écart entre deux mondes, celui du camp et celui sans le camp. Loin donc est l’idée d’une « désubjectivation » (Delvaux 2011 : 221) telle que peuvent l’évoquer Primo Levi par la figure du Doppelgänger (voir 1985) ou Giorgio Agamben (voir 1998) lorsque ce dernier met celle-ci en relation avec la dépersonnalisation poétique. Au contraire, on assiste chez Delbo à une « resubjectivation » où les sujets se reconstruisent et se redéfinissent, dans un acte performatif, à travers le témoignage de cette reconstruction. En effet, il s’agit de plusieurs « je » sensibles, à nouveau réceptifs à leur environnement propre (bien que Poupette qualifie cette sensibilité d’« écorchée » [Delbo 2018 : 273]), se présentant sous forme de narrateur·rice·s individuel·le·s apportant leur voix au récit polyphonique. Ce « je » a également une valeur englobante et se fonde dans une communauté du « nous » des victimes et des survivant·e·s (voir Segler-Meßner 2015 : 83). En ce sens, la communauté n’instaure que le rapport d’« être singulier » à « être singulier ». Selon le philosophe Giorgio Agamben, cela signifie que chaque individu, chaque « être singulier »
[…] est retiré de son appartenance à telle ou telle propriété, qui l’identifie comme membre de tel ou tel ensemble, de telle ou telle classe […] et il est envisagé non par rapport à une autre classe ou à la simple absence générique de toute appartenance, mais relativement à son être-tel, à l’appartenance même (1990 : 10).
La communauté évite donc d’avoir une essence qu’on lui suppose immanente. Elle accorde à chacun·e l’expérience et la mémoire non synthétisables et met en commun tous les mondes hétérogènes (voir Bernier 2014 : 56-57). En effet, les sujets énonciateurs dans chaque témoignage sont, en fin de compte, des êtres singuliers qui ont de nouveau acquis leur propre système de référence dans lequel ils et elles s’énoncent, font part de leurs expériences et se démarquent finalement en tant qu’individus délivrés de leur appartenance au groupe des victimes du camp. Cela participe néanmoins à l’élaboration de l’imaginaire communautaire relié à l’expérience concentrationnaire et donc à eux- et elles-mêmes. Ce qui résulte donc de cette écriture est l’évocation d’une réalité commune à partir d’expériences individuelles et singulières.
2.3 Les mots pour le dire : relier le « nous » et le « vous » à travers l’écriture
Mesure de nos jours met le doigt sur le rôle du langage dans la mesure où celui-ci est l’instrument permettant de faire la distinction discursive entre les « je », les « tu » et les « nous ». L’identité collective au nom de plusieurs voix prend sa forme à l’aide des stratégies langagières mentionnées (le principe de dialogue au sein du jeu polyphonique, l’ancrage du « je » dans le « nous » communautaire). Or la question qui sous-tend également ce livre est celle de savoir comment confronter ce « nous », composé de plusieurs « je », avec le « vous », et donc comment faire le pont, à travers la mise en forme langagière, entre les mort·e·s, les (sur)vivant·e·s et ceux et celles qui n’ont pas vécu le camp, dans une optique de transmission des expériences.
Pour les témoins, il s’agit désormais de tenter la réhumanisation et donc d’inverser le lent « processus de la déshumanisation » (Oppenheim 2009 : 75) vécue au camp, celle où « les signes identitaires s’effa[çai]ent » (ibid.), pour trouver un équilibre avec les souvenirs traumatisants et réhabiter le quotidien. Le personnage de Mado nous livre un exemple : elle s’est mariée et a eu un fils dont elle suit la vie avec un vif intérêt maternel (voir Delbo 2018 : 206-207). Toutefois, dans son témoignage, elle clame un leitmotiv de survie : « Je vis sans vivre. Je fais ce qu’il faut faire. […] Je fais ce qu’on fait dans la vie, mais je sais que ce n’est pas cela, la vie, parce que je sais la différence entre avant et après » (Delbo 2018 : 201-202). La survivante a l’impression de vivre dans un ‘être double’, marqué par la différence entre avant et après, qui font qu’elle a deux ‘moi’ distincts, le ‘moi’ actuel et le ‘moi’ d’Auschwitz. Plusieurs autres témoignages soulignent cette duplicité, notamment celui d’Ida : « J’avais voulu fuir. D’ailleurs, c’est difficile à expliquer. J’étais double et je ne parvenais pas à réunir mes doubles. Il y avait moi et un spectre de moi qui voulait coller à son double et n’y arrivait jamais » (Delbo 2018 : 261).
Cette duplicité se retrouve aussi dans le langage : il y a un langage d’avant les camps et un langage d’après. Tout se passe comme si, au retour, un recalibrage du langage accompagnait le processus de réhumanisation et de réindividualisation des revenant·e·s que nous venons de décrire. Ghislaine Dunant constate à ce propos : « [l]a déshumanisation qu’elles [les victimes] ont vue et vécue, [avait] attaqué le sens des mots » (2016 : 380). Tout comme le ‘moi’ d’avant n’est plus le même que le ‘moi’ d’après, certains mots employés dans le texte ont subi un processus de désémantisation et de resémantisation, prenant des sens différents pendant la détention au camp et après le camp. La « foule », par exemple, une foule qui décrivait auparavant le « nous » de la masse des détenu·e·s dans le camp, surtout lorsque celle-ci devait se ranger en ligne pendant l’appel, devient, dans Mesure de nos jours, la foule des « vous », des inconnu·e·s qui bavardent, une foule dans laquelle Charlotte et Gilberte ne se retrouvent pas (voir Delbo 2018 : 169, 181). Mado constate : « Nous ne savons pas répondre avec vos mots à vous et nos mots à nous » (Delbo 2018 : 225). De la même manière, Charlotte évoque la restauration des significations des mots après le retour : « […] la réalité a repris ses contours, ses couleurs, ses significations, mais si lentement… » (Delbo 2018 : 173). Plus loin, Mado nous confirme encore :
Les mots n’ont plus le même sens. Tu les entends dire : “J’ai failli tomber. J’ai eu peur.” Savent-ils ce que c’est, la peur ? Ou bien : “J’ai faim. Je dois avoir une tablette de chocolat dans mon sac.” […] Tous leurs mots sont légers. Tous leurs mots sont faux. (Delbo 2018 : 211)
Comment regagner confiance dans le langage, sachant que cette confiance ne peut exister que quand les mots sont ‘justes’, adéquats à l’expérience vécue au camp de concentration ? La description elle-même de ce double processus de désémantisation et resémantisation des mots est un des procédés propres aux témoignages pour faire face à cette aporie, c’est-à-dire à l’impasse créée par l’incapacité du langage commun à exprimer pleinement l’horreur vécue. L’insertion de passages lyriques dans le texte en prose en est un autre : cette écriture multi-générique permet un va-et-vient entre l’intérieur du camp, souvent évoqué à travers les moments lyriques, et l’extérieur du camp (ou le post-camp), exprimé à travers la prose, et met ainsi en évidence le potentiel du langage à représenter l’indicible. Le témoin quant à lui – dont la voix est rendue audible à travers le texte de Charlotte Delbo – est la figure de jonction entre cet intérieur et cet extérieur. Il tente de se réinscrire dans le langage, de le réhabiter, et par ce langage, d’habiter le monde, celui d’après, et de renouer ainsi avec les vivant·e·s. Le livre est donc aussi un appel aux lecteurs et lectrices d’imaginer ce passage difficile d’un monde à l’autre : « Sortir de l’histoire pour entrer dans la vie, essayez donc vous autres et vous verrez » (Delbo 2018 : 230).
Références bibliographiques
Agamben, Giorgio (1990). La Communauté qui vient, Théorie de la singularité quelconque, Paris, Seuil.
Agamben, Giorgio (1998). Quel che resta di Auschwitz, Torino, Bollati Boringhieri.
Bakhtine, Mikhaïl (1984 [1929]). Problems of Dostoevsky’s Poetics, translated by Caryl Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Bernier, Émilie (2014). « L’amitié, ou l’impossible politique : la communauté dans la grammaire heideggérienne », Politique et Sociétés 33 (2), 39-62.
Delbo, Charlotte (2018 [1971]). Mesure de nos jours, Paris, Les Éditions de Minuit, tome III.
Dunant, Ghislaine (2016). Charlotte Delbo, La vie retrouvée, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Coquio, Catherine (2015). La littérature en suspens, Écritures de la Shoah : le témoignage et les œuvres, Paris, L’Arachnéen.
Delvaux, Martine (2011). « Charlotte Delbo : l’amitié », in: Caron, David & Sharon Marquart (eds.), Les Revenantes. Charlotte Delbo : La voix d’une communauté à jamais déportée, Toulouse, Presses Universitaires Du Mirail, 211-225.
Levi, Primo (1985). L’altrui mestiere, Torino, Einaudi.
Oppenheim, Daniel (2009). « La déshumanisation, y résister, se déprendre de ses conséquences, en témoigner », Les Lettres de la SPF 22 (2), 73-78.
Parent, Anne Martine (2011). « Communautés spectrales », in: Caron, David & Sharon Marquart (eds.), Les Revenantes. Charlotte Delbo : La voix d’une communauté à jamais déportée, Toulouse, Presses Universitaires Du Mirail, 128-130.
Rabaté, Dominique (1991). Vers une littérature de l’épuisement, Paris, J. Corti.
Ruffini, Elisabeth (2014). « La voix du narrateur, le corps et l’identité », in: Page, Christiane (éd.), Charlotte Delbo, Œuvre et Engagements, Rennes, PUR, 201-215.
Segler-Meßner, Silke (2015). « Le genre, le récit et le corps : Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo et L’espèce humaine de Robert Antelme », Romanische Studien 2, 81-104.
TLFi, « spectre », in: <http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=651807030;r=1;nat=;sol=1> [06.04.2024].
Waintrater, Régine (2000). « Le pacte testimonial, une idéologie qui fait lien ? », Revue française de psychanalyse, devoir de mémoire : entre passion et oubli 64 (1), 201-210.
- Bien que Ravensbrück fût un camp pour les femmes, le récit évoque également deux hommes. ↵
- La notion de polyphonie désigne une forme littéraire où plusieurs voix ou consciences indépendantes, dotées de leur propre point de vue, coexistent et interagissent au sein d’un même texte. Bakhtine a développé ce concept en analysant les romans de Fiodor Dostoïevski, qu’il considère comme l’exemple paradigmatique de la polyphonie (voir Bakhtine, trad. 1984 [1929] : 6 et suivantes). ↵