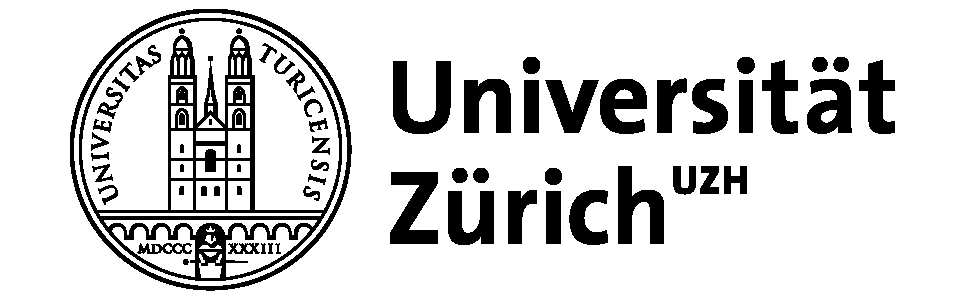Quand dire, c’est être : acheminement vers l’être-locuteur d’une langue ou d’une autre langue
Peiyao Xiong
Laboratoire ICLCH (Université de Wuhan) / Laboratoire CPTC (Université de Bourgogne)
Abstract: The question of language for identity purposes has always aroused deep interest in the history of linguistic research; the fact remains that language is one of the most determining foundations of identity. On this subject, Martin Heidegger (quoted in Auroux, Deschamps & Kouloughli 2004: 243) says that «[the] language is the house of being […]». To be more precise, language constitutes a place of being; the supreme purpose of the appropriation of a language or another language is explained, ipso facto, by the anchoring of the identity in the said language. Hence the following confirmation by Samir Bajrić (2013: 44, our translation): «[…] [S]peaking a language means being (existing) in this language». In this context, we will be interested, in a cognitive and philosophical way, in the phenomena due to the appropriation of a language or another language: on the one hand, we will elucidate the cognitive relations that outline the language and the speaker; on the other hand, we will linger particularly on the particularities manifested by the settled speaker of one language or another language, as well as on the choices of linguistic codes on the occasion of speech acts. It will be argued that belonging to a language or to another language results in forgetting the law imposed by the language; the settled speaker expresses himself in and through the said language, but the settled speaker experiences only himself or another self; the language, in this case, is an integral part of the settled speaker himself, but the fact remains that, according to Gustave Guillaume (1969: 277, note 8, our translation), «[a] language is a work constructed in thought on which is superimposed a work constructed in signs». If Samir Bajrić (2013: 44, our translation) writes: «We speak a language according to how well we have learned it. We learn it by knowing how to forge a psycholinguistic identity», we can also say: we convey a psycholinguistic identity according to how we knew how to be. We are depending on whether we have been able to position ourselves in this or that language. Or, in a word: when to say is to be.
c
Keywords: linguistic identity; mental spaces; settled speaker; linguistic neoteny
1 Introduction
Dans le contexte de mondialisation sociale et de pluralisme culturel de notre siècle, le phénomène du plurilinguisme est omniprésent ; le poids des langues relève, ipso facto, d’une force cruciale dans la formation identitaire de l’être humain. En l’occurrence, le questionnement sur les relations qu’entretiennent la langue et le locuteur constitue l’une des préoccupations majeures des linguistes. Selon Novarina (1999: 15-16),
[les] mots préexistent à ta naissance. Ils ont raisonné bien avant toi. Ni instruments ni outils, les mots sont la vraie chair humaine et comme le corps de la pensée : la parole nous est plus intérieure que tous nos organes de dedans. Les mots que tu dis sont plus à l’intérieur de toi que toi. Notre chair physique c’est la terre, mais notre chair spirituelle c’est la parole ; elle est l’étoffe, la texture, la tessiture, le tissu, la matière de notre esprit.
En effet, la langue habite notre chair spirituelle, qui se distingue de notre chair physique, la langue constitue un lieu d’être de la pensée si nous sommes d’accord avec l’idée du philosophe Henri Delacroix (cité dans Guillaume 1973: 245) selon laquelle « […] la pensée fait le langage en se faisant par le langage [c’est-à-dire par un langage intérieur] ». Dans cette présente étude, nous allons nous interroger particulièrement sur les problèmes liés à l’appropriation d’une langue ou d’une autre [1] langue : en premier lieu, nous éluciderons les nouvelles terminologies pour les liens qu’esquissent la langue et le locuteur ; en second lieu, nous préciserons les choix des codes linguistiques quand nous apprenons une autre langue ; en troisième lieu, nous rechercherons, de manière cognitive et philosophique, les particularités que manifeste l’être-locuteur d’une langue, et nous proposerons, mutatis mutandis, une nouvelle terminologie pour la qualité que possède l’être-locuteur d’une langue.
2 De l’être cognitif à l’être-locuteur
En tant qu’êtres humains, nous sommes dotés, dès la naissance, de systèmes cognitifs et du potentiel du langage, et après la naissance, nous améliorons sans cesse le système du langage, qui est l’un de nos systèmes cognitifs si nous adoptons le point de vue des sciences cognitives (cf. Changeux 2012), tout en nous approchant de l’être-locuteur. Comme le dit André Jacob (2010: 151) :
Le Sujet, coextensif à l’Instant (in-stans), résulte d’un « devenir Sujet » de l’individu, c’est-à-dire d’un corps qui, debout (stans) dans l’espace, ne sort pas d’un présent quasi animal. En se structurant linguistiquement pour dire son expérience – à d’autres Sujets – il unit la singularité de son expressivité à l’universalité latente de la communication. La langue est bien un foyer dense et rayonnant pour la condition humaine : conjoignant la tension de virtualités en chacun de nous et l’extension à des groupes plus ou moins vastes.
En effet, quand nous apprenons une langue ou une autre langue, nous améliorons sans cesse les rapports cognitifs entre nous et la langue que nous apprenons. D’où l’affirmation suivante de Samir Bajrić (2017: 62) :
Si les langues sont sujettes au changement et si les éléments, externes et internes, qui déterminent leur évolution « entraînent, sous l’effet du temps, des modifications considérables », il n’en demeure pas moins que les rapports cognitifs existant entre langues et locuteurs deviennent également objets de variation. En d’autres termes, ce qui permet d’identifier le degré d’ancrage identitaire d’un locuteur donné, dans une langue donnée, à un moment donné de son existence, ce n’est pas la chronologie des langues côtoyées, mais le type de rapport cognitif qu’il entretient en synchronie avec telle langue ou avec telle autre.
Il va de soi, en effet, que le changement de rapport cognitif entre le locuteur et la langue qu’il apprend s’explique par le changement de rôles du locuteur et de la langue côtoyée.
Du point de vue du locuteur, les rapports cognitifs qu’esquissent le locuteur et la langue qu’il apprend montrent une particularité binaire : soit le locuteur existe dans une langue, soit, à l’inverse, le locuteur n’existe pas dans ladite langue. D’où la dichotomie suivante :
Le locuteur non confirmé désigne tout individu dont la maîtrise de la langue, quelles qu’en soient les raisons, se révèle inférieure à celle du locuteur confirmé. Inversement, le terme locuteur confirmé se réfère à tout individu dont le sentiment linguistique est suffisamment fiable et développé pour formuler des jugements d’acceptabilité sur des énoncés produits dans la langue (Bajrić 2006: 118).
Et du point de vue de la langue, celle-ci peut soit être méconnue par un locuteur, soit être connue par un locuteur qui n’y existe pas encore, soit être connue par un locuteur qui y existe. En l’occurrence, du locuteur non confirmé au locuteur confirmé, les rapports cognitifs qu’esquissent le locuteur et la langue qu’il apprend montrent une particularité ternaire :
– langue in posse : toute langue naturelle dans laquelle le locuteur reconnaît ou non à peine quelques sonorités ;
– langue in fieri : toute langue dans laquelle on peut communiquer, à des degrés variables, mais dont on ne possède pas un sentiment linguistique développé ;
– langue in esse : toute langue dont on possède l’intuition grammaticale correspondante et un degré très élevé de sentiment linguistique (Bajrić 2006: 115-116).
En un mot, si nous méconnaissons une langue, alors cette langue est pour nous une langue en puissance ; si nous connaissons une langue mais nous n’y existons pas encore, alors cette langue est pour nous une langue en devenir ; si nous connaissons une langue et nous y existons, alors cette langue est pour nous une langue en être.
3 Sujet pensant versus sujet parlant
Selon la psychomécanique du langage, l’acte du langage n’est qu’une transition des traitements mentaux aux traitements phonétiques :
On n’exprime qu’à partir de ce qui a été préalablement représenté ; en formule simplifiée : langage = représentation (langue) + expression (discours). La langue représente le langage puissanciel, conditionnant à l’endroit du discours, parlé ou écrit, qui est du langage effectif (Boone & Joly 2004: 350).
Il n’en reste pas moins vrai que, d’après Gustave Guillaume (cf. 1973: 64-72), le langage est la langue associée au discours, et que la langue – le langage puissanciel – relève de la représentation se trouvant en amont, et le discours – le langage effectif – relève de l’expression se situant en aval. En l’occurrence, le sujet énonciateur, c’est-à-dire le locuteur, se constitue à la fois du sujet pensant et du sujet parlant ; comme sujet pensant, nous nous trouvons en amont, et comme sujet parlant, nous nous situons en aval.
Inspiré de la distinction entre le sujet pensant et le sujet parlant de Gustave Guillaume, Samir Bajrić (2017: 60) a pensé autrement et l’a introduit dans des phénomènes d’appropriation des langues naturelles :
Cognitivement parlant, l’homme contemporain entretient deux types de rapports avec le phénomène langagier. Le premier type est celui des rapports intralinguistiques, ceux que l’ensemble des individus entretiennent avec une langue qui leur est commune. Là encore, la pluralité est de mise, dans la mesure où « il y aurait dans le monde autant de langues que d’individus qui les parlent » (Wilhelm von Humboldt). Le second crée des rapports interlinguistiques. Il renvoie à chacun des individus en particulier, à la manière dont il est / devient / diminue d’être / redevient, etc. sujet pensant et sujet parlant des langues qu’il maîtrise / connaît / comprend / appréhende, etc.
Pour être plus précis, pour le cas du monolinguisme, comme sujet pensant, nous pensons plus ou moins inconsciemment tout en nous enracinons dans une langue in esse dans laquelle nous sommes un locuteur confirmé, et nous ordonnons la représentation de cette langue. Comme sujet parlant, nous traitons l’expression de ladite langue.
Mais quand nous apprenons une autre langue, comme sujet pensant, si nous sommes un locuteur confirmé de la langue que nous apprenons, alors nous pouvons ordonner la représentation de la langue que nous apprenons, et cette langue est pour nous une langue in esse ; si nous sommes un locuteur non confirmé de la langue que nous apprenons, alors nous pensons inconsciemment dans la langue déjà intériorisée, et nous ne pouvons que traiter la représentation de la langue déjà intériorisée ; cette langue déjà intériorisée est aussi pour nous une langue in esse. Comme sujet parlant, si nous sommes un locuteur confirmé de la langue que nous apprenons, alors le locuteur confirmé traite l’expression d’une langue in esse ; mais si nous sommes un locuteur non confirmé de la langue que nous apprenons, alors le locuteur non confirmé ordonne l’expression d’une langue in fieri dans laquelle il n’existe pas encore. Soit figurativement :
|
Gustave Guillaume
|
Sujet énonciateur = sujet pensant + sujet parlant
(Acte de langage = acte de représentation + acte d’expression)
|
|||
|
Samir Bajrić
|
Cas du monolinguisme
|
Sujet pensant –> représentation d’une langue in esse
|
||
|
Sujet parlant –> expression d’une langue in esse
|
||||
|
Cas de l’appropriation d’une autre langue
|
Sujet pensant
|
Locuteur confirmé | Représentation d’une langue in esse | |
| Locuteur non confirmé | Représentation d’une langue in esse | |||
|
Sujet parlant
|
Locuteur confirmé | Expression d’une langue in esse | ||
| Locuteur non confirmé | Expression d’une langue in fieri | |||
Si l’être-locuteur revoie à celui qui existe au moins dans une langue quelconque, alors quelles sont les particularités que manifeste l’être-locuteur d’une langue ?
4 L’homme et la langue ne font qu’un
Dans son œuvre célèbre Être et Temps, Martin Heidegger (cf. 1986: 86) préconise l’idée que l’homme, se situant au sein du monde, est un être-là (allemand Dasein). Selon lui, l’être-au-monde constitue un élément primordial de la notion de Dasein, et il (ibid.) indique ceci : « L’expression composée “être-au-monde” montre déjà à la façon dont elle est frappée qu’il s’agit avec elle d’un phénomène unitaire ». En l’occurrence, l’être-au-monde ne s’explique pas simplement par « être dans […] [le monde] » (ibid.: 87), sa caractéristique ontologique souligne une philosophie existentielle et une conception d’ensemble. Autrement dit, l’être-au-monde reconnaît l’existence d’une harmonie entre l’étant – celui qui existe – et le monde ; cette harmonie relève d’une concomitance et d’une valorisation mutuelle entre le sujet et l’objet.
Dès lors, la notion d’harmonie entre l’homme et la langue voit le jour naturellement, elle conçoit l’homme et la langue comme deux êtres au monde connaissant une concomitance et une complémentarité. Pour le dire en un mot, l’homme et la langue ne font qu’un.
Cette harmonie elle-même véhicule deux perspectives : la première est une perspective néoténique, qui renvoie, dans l’appropriation d’une langue ou d’une autre langue, à un état où l’être-locuteur énonce des discours en toute spontanéité tout en ignorant les opérations mentales, voire l’existence de la langue dans sa chair et son existence dans la langue. C’est un état où la langue fait partie intégrante de notre chair, qui ne se trouve que dans le locuteur confirmé selon la théorie de Samir Bajrić. La deuxième perspective est une perspective philosophique, qui souligne un rapprochement bidirectionnel ; il n’existe pas nécessairement de hiérarchies entre les deux – le fait est que l’homme existe dans la langue et en même temps, celle-ci existe aussi dans celui-là.
Martin Heidegger (1976: 13-15) mentionne, dans Acheminement vers la parole, non seulement que « [l]’être humain parle », mais aussi que « […] la parole [la réalisation de la langue] est parlante », et il (ibid.: 37) précise : « L’homme ne parle que dans la mesure où il correspond à la parole ». En clair, peu importe que l’homme s’aligne sur la parole ou que la parole s’aligne sur l’homme, ce qui est important, c’est que l’homme parle au moment où l’homme et la parole se croisent. Ainsi, philosophiquement parlant, c’est un moment où l’homme existe dans la parole et la parole aussi dans l’homme ; et néoténiquement parlant, on place, ici, le point-clé sur l’homme. Au cours de l’acheminement vers la langue, l’état d’harmonie se traduit par un oubli de l’existence de ladite langue. Ce qui est touchable, ce n’est que l’homme lui-même ou un autre soi-même, c’est parce que « j’y suis » (Xiong 2021) déjà, dans le langage par antériorité, remis à lui dans une simultanéité d’impressions sensibles, d’images et de représentation, que l’harmonie de l’homme et de la langue nous permet d’être Un.
Si Samir Bajrić (2013: 44) préconise que « […] la finalité suprême de l’apprentissage d’une autre langue est de se forger une nouvelle (une deuxième) identité psycholinguistique, personnelle par définition et conforme au génie de la langue que l’on apprend », nous pouvons définir cette finalité suprême avec la notion d’harmonie entre l’homme et la langue. Cette harmonie s’explique par une cessation de la démarcation entre l’être de l’homme et celui de la langue ; il s’agit d’un état épistémologique où l’homme et la langue ne font qu’un.[2]
Ainsi, dans une perspective néoténique, et dans une perspective philosophique tout en s’attardant sur l’être-locuteur, on dirait : « Je parle, donc j’y suis »[3] (Xiong 2021). La langue comme fondatrice et instauratrice d’un lieu qui authentifie, qui prouve la présence de soi à soi, la présence du locuteur à lui-même et aux autres et à l’autre par le langage. Nous parlons, donc le langage nous fait exister là où il est ; nous habitons le lieu du langage en tant qu’il donne existence à la parole qui nous fait vivre avec lui, par lui et en lui.
5 Conclusion
André Jacob (2011: 81) écrit : « [Quel] que soit son caractère instrumental, la langue ne pourra pas s’ajouter à la pensée comme un vêtement indifférent au corps qui l’habite ». La langue constitue, ipso facto, un lieu d’être, et l’appartenance à une langue permet d’obtenir une identité linguistique. Apprendre une autre langue nous permet d’errer d’une langue à l’autre, c’est aussi un moment où nous échappons à l’emprise identitaire de la langue in esse dans laquelle nous sommes un locuteur confirmé et que nous cherchons à être autrement.
À dire vrai, le phénomène d’harmonie entre le locuteur et la langue s’explique par l’oubli de la loi qu’impose cette langue ; pour être plus précis, celui qui existe dans une langue quelconque et atteint l’harmonie entre soi-même et la langue est celui qui a oublié le caractère instrumental de la langue et celui qui refuse de penser dans une autre langue dans laquelle il est un locuteur confirmé. Il n’en demeure pas moins qu’« [apprendre], c’est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies, c’est aussi éliminer les autres » (Changeux 2012: 303). Si Samir Bajrić (2013: 44) écrit : « On parle une langue selon qu’on a su l’apprendre. On l’apprend selon qu’on a su s’y forger une identité psycholinguistique », nous pouvons aussi dire : on véhicule une identité psycholinguistique selon qu’on a su être. On est selon qu’on a su se positionner dans telle ou telle autre langue. Ou : quand dire, c’est être.
Références bibliographiques
Auroux, Sylvain, Jacques Deschamps & Djamel Kouloughli (2004). La Philosophie du langage, Paris, Presses Universitaires de France.
Bajrić, Samir (2006). « Quelle(s) langue(s) parlons-nous ? Problèmes de transfert et de traduction de concepts », Syntaxe et Sémantique 7, 107-123.
Bajrić, Samir (2013/2009). Linguistique, cognition et didactique. Principes et exercices de linguistique-didactique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne.
Bajrić, Samir (2017). « Langues et locuteurs : synchronie contre chronologie », in: Badiou-Monferran, Claire, Samir Bajrić & Philippe Monneret (éds.), Penser la langue. Sens, texte, histoire, Paris, Champion, 57-64.
Boone, Annie & André Joly (2004/1996). Dictionnaire terminologique de la systématique du langage, Paris, L’Harmattan.
Changeux, Jean-Pierre (2012). L’Homme neuronal, Paris, Fayard/Pluriel.
Guillaume, Gustave (1969). Langage et sciences du langage, Paris/Québec, Librairie Nizet/Presses de l’Université Laval.
Guillaume, Gustave (1973). Principes de linguistique théorique de Gustave Guillaume, Paris/Québec, Klincksieck/Presses de l’Université Laval.
Heidegger, Martin (1976). Acheminement vers la parole, traduit de l’allemand par Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier & François Fédier, Paris, Gallimard.
Heidegger, Martin (1986). Être et Temps, traduit de l’allemand par François Vezin, Paris, Gallimard.
Jacob, André (2010). « La Langue, foyer de la condition humaine. Hommage à Gustave Guillaume », Diogène 232, 147-152.
Jacob, André (2011/1970). Les Exigences théoriques de la linguistique selon Gustave Guillaume, Paris, Champion.
Novarina, Valère (1999). Devant la parole, Paris, P.O.L.
Piaget, Jean (1964). Six études de psychologie, Paris, Éditions Denoël Gonthier.
Sartre, Jean-Paul (1943). L’Être et le Néant, Paris, Gallimard.
Xiong, Peiyao (2021). « Je suis, je parle, donc j’y suis : étude cognitive et philosophique de la néoténie linguistique » (Actes du colloque Cognition et être-locuteur : enjeux et perspectives de la néoténie linguistique. Université de Bourgogne, France), in: <https://u-bourgogne.hal.science/hal-03522735v1> [17.08.2024].
- Jean-Paul Sartre (1943: 285) a écrit, dans L’Être et le Néant : « […] autrui, c’est l’autre, c’est-à-dire le moi qui n’est pas moi […] ». Selon lui, l’autre renvoie au contraire du même. Ici, nous adoptons le sens philosophique d’autre, et une autre langue est celle qui ne véhicule pas la même existence pour le locuteur, d’où sa forme en italique. ↵
- En général, on éprouve des difficultés à définir précisément le seuil d’harmonie entre l’homme et la langue dans des cas précis. Mais conformément aux schèmes de Jean Piaget (1964), un enfant monolingue peut atteindre l’état d’harmonie entre l’homme et la langue à partir de 10 ou 12 ans. À partir de cet âge, il peut commencer à résoudre systématiquement et logiquement des problèmes abstraits. ↵
- Bien sûr, selon la néoténie linguistique, on peut aussi parler une langue sans y exister, c’est-à-dire que, lorsque l’on s’approprie une autre langue, notre cerveau est assujetti aux particularités cognitives de la source linguistique in esse correspondante, sans comprendre le monde par la médiation des locuteurs confirmés de la langue que l’on apprend. Mais ici, d’un point de vue heuristique, ce n’est que pour souligner l’objet suprême de l’assimilation d’une langue : le but de la domination d’une langue ou d’une autre langue est d’appréhender le monde au moyen de ladite langue et d’être un autre soi-même par un processus néoténique ; d’un point de vue philosophique, l’homme parle et existe au sein d’une langue quand l’homme et la parole se rencontrent. ↵