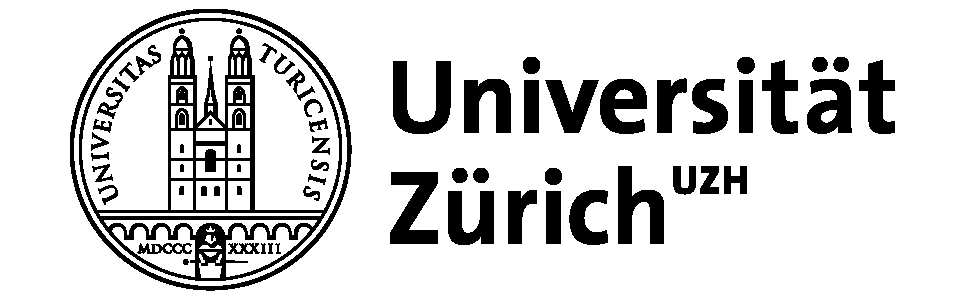L’anomalie ou l’écriture de l’identité dédoublée
Ariane de Testa
Université de Zurich
Abstract: Hervé Le Tellier’s L’anomalie is characterised by interwoven plots and multiple perspectives translated into different literary styles and genres. In the process, a textual identity of its own gradually emerges. Added to this is the doubling of a plane – an anomaly that gives rise to a paradox, that of the multiple one – which represents the main plot. This main plot, which brings identical characters face to face with another version of themselves, calls into question the limits of traditional identity as well as conventional notions of individuality and singularity. Full of very serious topics and existential questions, the book is also riddled with literary and pop-culture references which may amuse readers, leading them into the abyss of possibilities in an unprecedented but typically Oulipian way.
c
Keywords: Hervé Le Tellier; Oulipo; identité; L’anomalie; double
1 L’anomalie du double
L’anomalie de Hervé Le Tellier, publié chez Gallimard en 2020 et livre lauréat du prix Goncourt de la même année, met en scène le phénomène paradoxal de l’identité dédoublée. Le roman propose aux lecteurs et aux lectrices de se confronter à la question de la duplicité voire de la multiplicité de soi dans une réalité alternative, mais très proche de la nôtre. L’intrigue du roman se déroule en 2021, soit un an après la parution du livre. L’exploration de l’identité dédoublée se fait à travers une douzaine de personnages hétéroclites, qui n’ont, à première vue, aucun lien entre eux : un tueur à gages, un chanteur, une petite fille victime d’attouchements sexuels par son père, un architecte, une avocate, un auteur-traducteur etc. Leur point commun est le fait qu’ils ont tous et toutes emprunté le même vol allant de Paris à New York. Jusque-là, rien d’anormal, mais lorsque le commandant de bord et son premier officier demandent à atterrir à la suite de turbulences extrêmes, ils apprennent par le FBI qu’un autre avion identique – avec le même équipage et les mêmes passager·ère·s – s’était déjà posé sur le sol américain trois mois auparavant. Les services du FBI, de la NSA ainsi que des représentants de la Maison Blanche embauchent des mathématicien·ne·s, des physicien·ne·s, et des comités d’éthique qui vont procéder à une confrontation des doubles pour tenter de comprendre ce qui a eu lieu.
La représentation du dédoublement est un dispositif qui permet à l’auteur de confronter ses personnages à eux-mêmes et d’explorer ainsi les différentes réactions humaines face au dédoublement identitaire, à l’anomalie, en question. Il s’agit d’un dispositif ludique qui remet en question la notion d’individualité au sens traditionnel du terme. Le caractère expérimental du livre rejoint la logique créative de l’Oulipo (voir Oulipo 1973 ; Oulipo 1981) dont Hervé Le Tellier est membre depuis 1992 et président depuis 2019 (voir « Hervé Le Tellier » sur le site de l’Oulipo).
Pourtant, le dédoublement ne concerne pas seulement les personnages, mais également le livre qu’on est en train de lire, car Victor Miesel, un des personnages de L’anomalie, écrit un livre qui porte le même titre que celui qui nous intéresse à une majuscule près. L’analyse des deux modes de dédoublement que présente le texte (un personnage se trouve en situation où il est face à un autre mais avec qui il partage la même identité, ainsi que la mise en abyme) nous conduira à la question de l’apparition d’une identité textuelle qui émerge sous des contraintes particulières. Autrement dit, la thématique du dédoublement nous invite à réfléchir sur la tension entre écriture sous contrainte et émergence d’un texte singulier qui, nous le verrons, va de pair avec une expérience de lecture particulière.
1.1 Un éventail de personnages et de styles
Comme nous l’avons évoqué, L’anomalie est l’histoire d’une multitude de personnages. Ceux-ci sont soit personnellement concernés par le dédoublement identitaire, soit amenés à résoudre le problème que le dédoublement de l’avion et des personnes à bord pose. Les trois parties qui composent le livre s’organisent comme suit : dans la première « Aussi noir que le ciel », on accompagne certains personnages dans leur quotidien et on comprend deux choses fondamentales : (1) de nombreux personnages ont fait le même trajet en avion, (2) lors de turbulences, l’avion s’est dédoublé. La deuxième partie « La vie est un songe, dit-on »[1] est la partie dans laquelle la confrontation des doubles est organisée. Enfin, la troisième partie, « La chanson du néant », met en scène les personnages pendant et après la confrontation. Le livre commence par la présentation de plusieurs d’entre eux. Chacun des chapitres, lié à un personnage particulier, est écrit selon les codes stylistiques d’un genre littéraire qui concorde avec l’histoire du personnage en question. Le premier chapitre prend ainsi des allures de thriller pour nous introduire dans le monde de Blake, le tueur à gages, ce qui se manifeste à travers un style intense, dans une écriture blanche (voir Barthes 1953 ; Rabaté & Viart 2009) traduite par des phrases courtes et une multiplication de verbes à l’indicatif :
Tuer quelqu’un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup, et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l’univers rétrécisse, rétrécisse jusqu’à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C’est tout. Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça. […] Blake fait sa vie de la mort des autres. (Le Tellier 2020 : 13)
Il y a une coïncidence systématique entre un personnage représenté et un style générique (littéraire) qui lui correspond et la multitude de chapitres présentant chacun un personnage dans un genre littéraire propre permet à Hervé Le Tellier d’explorer le thème de l’identité sur un premier niveau : l’écriture, le style employé, devient le reflet identitaire des différents personnages. L’identité complexe du livre est ainsi le résultat d’une multiplication de personnages et d’intrigues dans des styles différents. Le fait que tous les personnages, venus des horizons les plus divers, entrent en contact dans l’avion, permet à l’auteur de déployer un éventail de personnages représentatif de la diversité de notre société contemporaine. Cette diversité des personnages et des réalités vécues, mise en évidence par la variété de styles littéraires différents, laisse deviner que, peut-être, le véritable protagoniste de L’anomalie, est le monde en période de crise.
1.2 Un autre comme soi-même ?
La lecture commence par le chapitre consacré à Blake, le tueur à gages, que l’on suit dans quelques missions en mars et juin 2021. Le chapitre initial se clôt sur une scène dans laquelle « Blake boit son café, sans sucre ni inquiétude. Il lit le livre conseillé par Flora ; il n’a pas avoué à sa femme qu’il a reconnu l’auteur dans le Paris–New York de mars dernier. […] À trente mètres de lui, un homme à capuche l’observe, le visage fermé. » (Le Tellier 2020 : 24) En tant que tueur professionnel, il se voit infligé à lui-même ce qu’il a l’habitude de faire aux autres : observer, épier, espionner avant de passer à l’acte et de tuer. Pourtant, à ce stade nous ignorons encore tout sur le fait qu’il s’agit là du deuxième Blake qui veut éliminer le premier. Même le Blake buvant son café ne reconnaît pas son double, bien évidemment déguisé. Cet effet de miroir, sans qu’il y ait de reconnaissance réciproque déconcerte et relève de l’« étrangement inquiétant » – das Unheimliche – qu’on connaît depuis E.T.A Hoffmann.[2]
Ce n’est qu’au chapitre 5, intitulé « La lessiveuse », que nous apprenons explicitement que l’avion, un Boeing 787 du vol AF006 sur le trajet de Paris à New York, tente de se poser à l’aéroport JFK pour la seconde fois le 24 juin 2021, après l’avoir déjà fait en mars. Pour distinguer les personnages et les vols des avions identiques, ceux-ci sont surnommés « March » et « June » (voir par exemple Le Tellier 2020 : 243-245). Bien plus loin, dans la seconde partie du livre, on découvre même que :
L’avion sur la piste est en tout point identique à ce 787 qui s’est posé le 10 mars. Certes, l’appareil a été réparé, certes, les passagers ont vieilli : on fête le soir même à Chicago les six mois d’un bébé qui, dans le hangar, est un nouveau-né hurleur de deux mois. Dans ces cent-six jours qui séparent les deux atterrissages, parmi les deux cent trente passagers et treize membres d’équipage, une femme a accouché et deux hommes sont décédés. Mais génétiquement, ce sont les mêmes individus. (Le Tellier 2020 : 144)
Cela explique pourquoi les deux David Markle, commandants de bord de l’avion, seront atteints du même cancer du pancréas. Dans le chapitre intitulé « Same player dies again », leur frère Paul, médecin, dit à David Markle (« June ») : « Tu as été ton propre cobaye, au moins on sait mieux ce qui ne marche pas. » (Le Tellier 2020 : 249) Cependant, même si les doubles des personnages sont extrêmement similaires, ils peuvent aussi présenter des différences subtiles, révélant ainsi des aspects cachés de leur personnalité. Un exemple parlant est celui de Victor Miesel, l’écrivain. Celui qui atterrit en mars écrit un livre « fluctuant entre lyrisme et métaphysique » (Le Tellier 2020 : 31) intitulé « L’Anomalie », et, le 22 avril « [a]yant posé ces mots, envoyé le fichier à son éditrice, Victor Miesel, envahi par une angoisse intense sur laquelle il ne parvient pas à mettre un nom, enjambe le balcon, en tombe » (Le Tellier 2020 : 31-32). Notons qu’un autre Victor Miesel, un personnage inventé quelques années plus tôt dans le premier livre de l’auteur Victor Miesel, s’était également tué un mois d’avril : « Oui, c’est là, précisément là que fin avril ont été dispersées les cendres d’un autre Victor Miesel. Le héros de son premier roman, Les montagnes viendront nous trouver, avait choisi d’y venir mourir d’un acte volontaire […] » (Le Tellier 2020 : 265)[3]. Quelques mois plus tard, le double de cet auteur mort deux fois (une fois dans le livre Les montagnes viendront nous trouver et une autre fois après la rédaction de « L’Anomalie »), interrogé par un agent, répond à la question de savoir s’il écrit un livre en ce moment : « Je… je traduis un roman fantastique d’un auteur américain, une histoire de teenagers vampires… » (Le Tellier 2020 : 157). L’agent insiste : « Mais travaillez-vous sur un livre plus personnel, un livre dont le titre sera L’Anomalie ? ». Réponse de Miesel : « L’Anomalie ? Non. Pourquoi cette question ? » (Le Tellier 2020 : 157) Le Victor Miesel ayant atterri en juin affirme d’ailleurs : « […] les raisons de ce geste m’échappent totalement. Je ne suis pas suicidaire. » (Le Tellier 2020 : 271)
Il faut noter également que face à la confrontation aux doubles, les réactions des personnages sont diverses : Blake va supprimer son double, un enfant va devoir choisir entre deux versions de sa mère et l’une des mères va devoir renoncer à son fils. D’autres personnages se complètent très bien : comme les deux versions du chanteur nigérian appelé Slimboy : « Les deux chanteurs se répondent, enrichissent sans jamais surenchérir sur l’autre » (Le Tellier 2020 : 244). Ils choisissent de se faire connaître comme des jumeaux, l’un présentant son “frère” au public en annonçant un changement de leur nom d’artiste : de Slimboy, ils passent à SlimMen (Le Tellier 2020 : 246). Ce choix – SlimMen au lieu de Slimboy(s) – rend en quelque sorte compte du fait que la somme des deux mêmes en fait une entité autre, plus mature et aboutie peut-être. Les différents rapports qu’entretiennent les personnages avec leurs doubles permettent aux lecteurs et aux lectrices de questionner le rapport à l’autre tout autant que le rapport à eux-mêmes.
2 La mise en abyme ou « L’Anomalie » dans L’anomalie
Revenons à Victor Miesel. Victor Miesel (de mars) est un écrivain sans succès qui se suicide juste après avoir envoyé son dernier roman intitulé « L’Anomalie » à son éditeur. Ce roman, il l’avait signé Victør Miesel, pseudonyme caractérisé par le o barré, qui, comme le livre nous l’apprend : « n’est que le symbole de l’ensemble vide. Une coquetterie tragique » (Le Tellier 2020 : 81). Ce graphème permet de marquer visuellement la différence identitaire entre le personnage et l’auteur. Cette lettre peut également être interprétée comme le signe de la scission : le ‹ o › est séparé par une barre oblique qui symboliserait le partage, en deux, d’une entité complète, et par extension, d’une identité. Doublement suicidé – dans son livre précédent et en “réalité” – ce Victor Miesel n’est pas le seul à écrire un livre à la suite de son vol Paris-New York. Le Victor Miesel qui atterrit en juin a lui aussi écrit un livre dont il termine la rédaction le 21 octobre 2021 :
Victor vient de poser le dernier mot au court livre qui raconte l’avion, l’anomalie, la divergence. Comme titre il a pensé à Si par une nuit d’hiver deux cent quarante-trois voyageurs […] Ce sera finalement un titre bref, un seul mot. Hélas, L’Anomalie était déjà pris. Il ne tente pas d’expliquer. Il témoigne, avec simplicité. Il n’a retenu que onze personnages, et devine qu’hélas, onze, c’est déjà beaucoup trop. (Le Tellier 2020 : 322)
Rappelons ici la citation qui décrit le récit-cadre :
L’avion sur la piste est en tout point identique à ce 787 qui s’est posé le 10 mars. Certes, l’appareil a été réparé, certes, les passagers ont vieilli […] Dans ces cent-six jours qui séparent les deux atterrissages, parmi les deux cent trente passagers et treize membres d’équipage, une femme a accouché et deux hommes sont décédés. Mais génétiquement, ce sont les mêmes individus. (Le Tellier 2020 : 144)
L’histoire – identique – du dédoublement de l’avion, le nombre – identique – de personnages dans celui-ci (243 = 230 passagers + 13 membres d’équipage), et la somme – identique – de personnages (11) dont il suit de plus près la trame narrative suggèrent que Victor Miesel est à comprendre comme le double de papier d’Hervé Le Tellier. Qui sait si le Victor Miesel de juin n’a pas nommé son livre L’anomalie avec un petit ‹ a ›, en sachant que « L’Anomalie » avec une majuscule était déjà pris, tout en signant ce livre sur l’avion par un autre pseudonyme (peut-être même par « Hervé Le Tellier ») ? Quoi qu’il en soit, Hervé Le Tellier joue avec les frontières entre les réalités extra- et intra-littéraires. Cela se confirme par les citations placées en exergue. L’anomalie est introduite par deux citations : la première « Et moi qui dis que vous rêvez, je suis aussi en rêve » est attribuée au célèbre penseur chinois Tchouang-Tseu. Juste en dessous, nous lisons « Le vrai pessimiste sait qu’il est déjà trop tard pour l’être », une phrase signée Victør Miesel et extraite de son livre « L’Anomalie ». À l’endroit où les lecteurs et lectrices s’attendraient à trouver un autre auteur réel, on trouve un auteur fictif, un personnage ou, plus précisément, un double d’un personnage du livre que l’on s’apprête à lire. Hervé Le Tellier continue ce procédé pour introduire les trois parties de son roman, sachant que les soi-disant citations de Victør Miesel sont, en fait, bien évidemment des citations d’Hervé Le Tellier.[4] En plus de jouer avec la frontière entre réalité et fiction, le livre permet aux lecteurs et aux lectrices de remettre en question les notions d’identité et d’individualité : lorsqu’un journaliste demande au Victor Miesel de juin : « – Considérez-vous que L’Anomalie soit un livre de vous ? » ce dernier répond : « – Définissez : vous. » (Le Tellier 2020 : 274)
3 Oulipo et identité textuelle émergente
En bon auteur de l’Oulipo, Hervé Le Tellier s’est aventuré dans l’écriture créative à partir de contraintes ; dans un entretien avec Guillaume Erner et Pierre Assouline (2021), il affirme : « L’œuvre se construit à partir de la contrainte, tout comme la contrainte nourrit l’œuvre ». À propos de L’anomalie, il explique lors d’une rencontre avec Jean-Michel Devésa (2021) : « Mort, suicide, maladie, abus sexuel, rencontre, séparation, le fait de tomber enceinte… J’ai exploré toute une série de situations qui permettait dès le départ, d’ensuite définir mes personnages. » Hervé Le Tellier avoue aussi avoir joué avec les codes d’un certain nombre de livres :
Je m’étais imposé que cette structure soit soutenue par des styles, très différents à chaque fois [et] derrière le style il y a aussi les personnages. Il fallait qu’ils soient incarnés en très peu de temps, parce que j’avais beaucoup, beaucoup de personnages et un livre assez dense et j’avais la question de la tresse de la structure que j’avais à mettre en place. (Assouline, Erner & Le Tellier 2021 : en ligne)
Ces contraintes sont comme les règles d’un jeu que se donne l’auteur et qui lui permettent de s’engager dans une aventure créative, de forger son identité textuelle et de se surprendre tant lui-même que son public par des œuvres uniques et inattendues.
3.1 Un jeu de piste
Pour le lecteur et la lectrice, L’anomalie a un caractère profondément ludique. On peut par exemple découvrir que le nombre 106 – qui est le nombre de jours entre les deux atterrissages des avions – est une référence à Georges Perec, puisqu’il s’agit de deux fois 53 et que « 53 jours » est le titre d’un roman inachevé de l’auteur oulipien (voir Jungerman & Le Tellier 2022). Il s’agit d’un roman qui fait lui-même référence à La Chartreuse de Parme de Stendhal, qui aurait été écrite en 53 jours (Perec 2022 [1989] ; voir également la préface de cette édition rédigée par Hervé Le Tellier). Les guillemets du titre (« 53 jours ») indiquent un renvoi interne à un autre texte (53 jours) mentionné dans le roman de Perec (ibid.). On se trouve donc devant la mise en abyme d’une mise en abyme, et peut-être est-il possible de mener ce jeu à l’infini, ce qui provoque un effet abyssal et confère au livre un caractère à la fois vertigineux et angoissant, mais aussi éminemment amusant.
3.2 Des possibilités infinies
Selon que l’on se laisse entrainer par le jeu ou non, il y a une multitude de lectures possibles, et cela en fonction de la posture et des connaissances des lectrices et des lecteurs. Mais même la lecture dite “conventionnelle” engage le lecteur et la lectrice d’une manière particulière. La dernière page du roman se présente ainsi comme un calligramme. Le nombre des signes s’y amenuise à chaque ligne pour ne plus contenir qu’une unique lettre, le tout formant un entonnoir, symbole de la canalisation, de la convergence ainsi que du processus de focalisation ou de concentration d’éléments dans un point central (Le Tellier 2020 : 327). Cette disposition en calligramme (qui rappelle d’ailleurs la couverture de l’édition de Perec 2022 [1989], préfacée par Hervé Le Tellier) incite les lecteurs et les lectrices à rétablir un texte fragmentaire, dont certains éléments manquent. Ce qui est intéressant dans ce processus, c’est que plus Hervé Le Tellier enlève des lettres à ce passage, plus il multiplie les possibilités de sens. Le fait qu’il n’y ait pas de point final au roman participe, bien évidemment, de ce jeu.
En somme, à travers des personnages troublés par leur double, l’auteur explore la pertinence des catégories de fiction et de réalité ainsi que celle du soi et de l’autre. Ce roman pousse le lecteur ou la lectrice à réfléchir sur sa propre identité et sur la complexité de l’être humain face à une réalité plurielle, complexe et ses divers potentiels. Rappelons que la date de publication du livre est 2020 et que les événements qui y sont décrits sont de 2021. Il s’agit donc, au moment de l’écriture d’un futur proche, d’une réalité alternative, d’une uchronie – pour le dire avec le néologisme de Charles Renouvier – dans laquelle l’objectif est d’imaginer toute une série d’autres trames historiques possibles, potentielles, et de les faire cohabiter. Au centre du roman se trouve donc une réflexion sur le pouvoir de la littérature de (re)créer le monde, mais aussi les mondes possibles ou impossibles. Autrement dit : c’est un jeu d’imagination. Le caractère ludique, drôle, est soutenu par de nombreux procédés comiques, notamment par des références à la pop culture. Ainsi le protocole déclenché par les services en charge de comprendre et de contenir l’anomalie est le protocole 42, 42 étant un clin d’œil à la réponse à la « grande question sur la vie, l’Univers et le reste » issue de l’œuvre de Douglas Adams Le Guide du voyageur galactique ou The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Le Tellier 2020 : 107). On peut donc dire en conclusion qu’aux côtés de toutes ces préoccupations existentielles et philosophiques se trouvent des plaisanteries, et que la lecture – comme l’écriture – gagne à être comprise comme un jeu.
Références bibliographiques
Assouline, Pierre, Guillaume Erner & Hervé Le Tellier (2021). Goncourt : l’anomalie littéraire. Avec Hervé Le Tellier, Comprendre le monde c’est déjà le transformer, « L’invité des Matins de France Culture », France Culture, in : <https://www.youtube.com/watch?v=DVLN5b1T5yo&t=983s> [28.07.2023].
Barthes, Roland (1953). Le Degré zéro de l’écriture ; suivi de nouveaux essais critiques, Paris, Seuil.
Devésa, Jean-Michel & Hervé Le Tellier (2021). « Rencontre avec Hervé Le Tellier et Jean-Michel Devésa autour de l’ouvrage “L’anomalie” aux éditions Gallimard et de l’écriture Oulipienne », Librairie Mollat, in : <https://www.youtube.com/watch?v=Ve1gZVrQyJM&list=WL&index=78> [31.07.2023].
Jungerman, Nathalie & Hervé Le Tellier (2022). « Entretien avec Hervé Le Tellier. Propos recueillis par Nathalie Jungerman », in : <https://fondationlaposte.org/florilettres/entretiens/entretien-avec-herve-le-tellier-propos-recueillis-par-nathalie-jungerman> [11.09.2023].
Le Tellier, Hervé (2020). L’anomalie, Paris, Gallimard.
Oulipo (1973). La Littérature potentielle, Paris, Gallimard.
Oulipo (1981). Atlas de Littérature potentielle, Paris, Gallimard.
Oulipo. « Hervé Le Tellier », in : <https://www.oulipo.net/fr/oulipiens/hlt> [11.08.2023].
Perec, Georges (2022 [1989]). « 53 jours », Paris, Gallimard.
Rabaté, Dominique & Dominique Viart (2009). Écritures blanches, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne.
Rank, Otto (1973). Don Juan et le Double. Études psychanalytiques, Paris, Petite bibliothèque Payot.
- Notons le clin d’œil à la pièce de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. ↵
- D’autant plus que, comme le rappelle Otto Rank, E.T.A Hoffmann, qui est reconnu comme l’un des précurseurs, si ce n’est le fondateur du fantastique, « est le poète classique du Double » en précisant que « [d]ans presque tous les ouvrages de Hoffmann, et ils sont nombreux, on trouve une allusion à ce thème et, dans quelques-uns parmi les plus importants, c’est même le thème dominant. » (Rank 1973 : 11) ↵
- Hervé Le Tellier fait dépasser un récit interne sur un récit-cadre en imaginant les cendres d’un personnage fictif (Victor Miesel) perçues par son auteur (Victor Miesel) dans le monde physique (celui de L’anomalie) dans lequel ce dernier est censé vivre. ↵
- Le questionnement (peut-être pas si naïf qu’il paraît au premier abord) qui en découle est de savoir si c’est l’auteur qui fait l’œuvre ou l’œuvre qui fait l’auteur. ↵